L’attachement est actuellement au cœur de nombreuses attentions cliniques. Et c’est une bonne chose.
De plus en plus d’approches thérapeutiques émergent, convoquant la théorie de l’attachement et ses concepts.
On parle de plus en plus, dans la littérature clinique, de « réparer l’attachement » — promesse séduisante s’il en est.
Ainsi, postulant que l’attachement est une cause critique du changement — c’est-à-dire que, si l’on parvient à faire bouger ce facteur, en somme tout ira mieux — de nombreux programmes se développent et s’implantent : Cercle de Sécurité©, Theraplay©, Intervention Relationnelle, ICV© pour les adultes, etc.
Mais il existe une distinction fondamentale entre les approches basées sur l’attachement et celles informées par l’attachement.
Cette distinction repose sur le focus thérapeutique, les méthodes utilisées et les preuves empiriques qui sous-tendent ces programmes d’intervention.
Dans cet article, je vous propose de clarifier les différences entre les approches basées sur l’attachement et celles informées par l’attachement, et de vous donner les moyens de questionner la recherche qui soutient le programme qui vous intéresse.
Car si beaucoup présentent des preuves empiriques d’efficacité, toutes ne peuvent pas revendiquer la mention « basées sur l’attachement ».
Table des matières
Comprendre la distinction
Il est important de commencer par clarifier une distinction souvent méconnue dans le discours clinique et institutionnel : celle entre les interventions informées par l’attachement et les interventions basées sur l’attachement. Ces deux termes ne recouvrent pas la même réalité (Obegi & Berant, 2010, p.3).
Dans la pratique clinique comme institutionnelle, cette nuance n’est généralement pas considérée. Le mot attachementdevient alors un mot-valise, un label qui confère une légitimité immédiate et attire les professionnels en quête de solutions thérapeutiques qu’ils espèrent efficaces, au regard de la puissance de la théorie elle-même — sans toujours interroger ce que les preuves scientifiques disent réellement.
Or, si notre objectif est véritablement de protéger les enfants, d’améliorer leurs trajectoires développementales et de réduire les risques de psychopathologie, nous ne pouvons pas faire l’économie de cette précision. Nous devons connaître les preuves empiriques et nous demander ce qui fonctionne vraiment.
Les interventions informées par l’attachement utilisent la théorie de l’attachement et les recherches qui en découlent comme une source majeure de connaissances. Concrètement, cela signifie que la théorie influence la manière dont les problèmes sont conceptualisés, évalués et traités. Mais la pratique, elle, reste adossée à un autre modèle thérapeutique déjà établi — thérapies cognitives et comportementales, thérapie familiale, psychothérapie interpersonnelle, etc.
Dans ce cas, la théorie de l’attachement sert surtout de grille de lecture complémentaire : elle est intégrée à la formulation clinique, mais n’en constitue pas le cœur. On est alors plutôt dans le registre des pratiques intégratives.
En recherche, on ne cherche pas forcément à démontrer un effet de l’intervention sur l’organisation de la stratégie d’attachement, mais plus généralement sur des indicateurs de souffrance psychique, comme dans la majorité des recherches en psychologie et en psychothérapie.
C’est généralement le cas dans la guidance parentale, ou, par exemple, dans certains usages de l’EMDR avec les enfants et les adolescents, ou encore dans les approches où l’on s’appuie sur les connaissances issues de l’attachement pour comprendre la difficulté d’un sujet et mieux cibler le traitement.
L’objectif de ces interventions n’est pas, à proprement parler, de modifier la stratégie d’attachement elle-même. Il s’agit plutôt de soulager des symptômes, de renforcer certaines compétences ou de soutenir la régulation émotionnelle, avec l’attachement comme référence théorique parmi d’autres, mais pas comme finalité unique.
Les interventions basées sur l’attachement, en revanche, ont un focus central sur l’attachement. Elles s’appuient explicitement — parfois même exclusivement — sur la théorie de l’attachement pour conceptualiser le développement, la psychopathologie, la personnalité et les dynamiques intra- et interpersonnelles.
Elles traduisent cette théorie en une structure thérapeutique codifiée, souvent sous la forme de programmes de formation. Leur objectif principal est de provoquer un changement dans la stratégie d’attachement, en favorisant le passage vers davantage de sécurité, conçue comme le principal facteur de protection en santé mentale.
C’est le cas, par exemple, du Cercle de Sécurité© (COS), du programme ABC© ou de Theraplay©. Ces approches ne se contentent pas d’intégrer l’attachement dans leur formulation : elles prétendent agir directement sur les stratégies d’attachement et cherchent à démontrer leur efficacité par des études empiriques.
En pratique, dans l’espace francophone (France, Belgique, Luxembourg), nous avons surtout affaire à des pratiques informées par l’attachement, même si ces programmes commencent peu à peu à s’implémenter.
On le comprend : pour se revendiquer basées sur l’attachement et fondées sur les preuves empiriques, il faudrait non seulement avoir pour focus l’attachement, mais aussi utiliser les méthodologies issues de la théorie (AAI, SSP, etc.), ce qui représente déjà un défi considérable.
Il faudrait surtout pouvoir démontrer des effets sur l’attachement lui-même, et non simplement sur des symptômes ou des comportements qui sont parfois — mais pas toujours — liés à l’attachement.
Autrement dit, le glissement souvent opéré consiste à considérer que, parce qu’il existe des preuves d’efficacité sur certains symptômes (dépression, troubles externalisés ou internalisés chez l’enfant, sensibilité parentale, etc.), on a nécessairement impacté et « réparé » l’attachement, alors qu’aucune preuve scientifique spécifique ne l’atteste.
En réalité, si l’on examine attentivement la littérature, on constate que nous avons bien plus souvent affaire à des programmes informés par l’attachement qu’à des programmes réellement basés sur l’attachement, car la preuve empirique d’un changement du système d’attachement est rarement, voire jamais, formellement rapportée.
Ce que cela change quand on lit la recherche
Prenons un exemple fréquent.
Un article conclut que « l’intervention a réduit les difficultés d’attachement ».
Spontanément, on imagine que les enfants sont passés d’une stratégie insécurisée à une stratégie sécurisée.
Mais si l’on regarde de plus près, les chercheurs ont souvent utilisé des questionnaires parentaux comme le CBCL, le TSCYC ou d’autres échelles de comportements.
Ces outils mesurent des symptômes : anxiété, agressivité, retrait, dysrégulation.
Ils ne mesurent pas l’attachement.
Les auteurs veulent dire que les comportements associés à des difficultés d’attachement ont diminué, pas que les stratégies d’attachement ont changé.
La confusion est facile : elle naît du langage, de cette façon implicite de parler de “difficultés d’attachement” comme d’un diagnostic alors qu’il s’agit d’un cadre d’interprétation.
Ce glissement n’est pas une faute morale.
Mais c’est un brouillage épistémologique.
Et il suffit d’un mot mal choisi pour qu’une hypothèse devienne, dans la lecture du public, une preuve.
Ce qu’on mesure, ce qu’on suppose
Les recherches sur les programmes qui proposent “d’améliorer l’attachement”, “de réparer l’attachement” ou “de diminuer les difficultés d’attachement” évaluent en réalité plus souvent :
- des comportements observables (retraits, colères, hyperactivité) ;
- la qualité des interactions ;
- la sensibilité ou la réceptivité du parent ;
- le bien-être général de l’enfant.
Ce sont des indicateurs précieux, mais indirects.
Ils reflètent la régulation émotionnelle, pas nécessairement la réorganisation du système d’attachement.
En revanche, les études qui prétendent mesurer l’attachement lui-même nécessitent un protocole bien plus exigeant : codage vidéo, analyses discursives, cotations croisées, fiabilité inter-juges…
Autrement dit, des moyens que peu de recherches appliquées peuvent se permettre.
C’est pourquoi la majorité des études publiées se situent dans une zone intermédiaire : elles observent des améliorations tangibles, sans pouvoir dire si ces changements touchent le cœur du système d’attachement ou seulement sa périphérie.
Cette démarche porte en elle la confusion habituelle entre corrélation et causalité, et l’idée implicite qu’améliorer les corrélats comportementaux reviendrait à transformer le système d’attachement.
Or, dans les faits, ces dimensions entretiennent des liens étroits avec l’attachement, mais elles n’en constituent pas le centre.
On peut améliorer la régulation, la communication ou la sensibilité parentale sans pour autant observer de modification mesurable des stratégies d’attachement.
Pourquoi cette distinction compte cliniquement
On pourrait se dire : après tout, peu importe que ce soit “basé” ou “informé”, du moment que ça aide les familles.
Et c’est vrai : si une approche améliore la qualité de vie, elle a déjà de la valeur.
Mais pour le clinicien, cette distinction reste cruciale.
Elle change notre posture, nos attentes, notre manière d’en parler aux parents.
Dire qu’une approche est “informée par l’attachement”, c’est affirmer qu’elle soutient les processus relationnels : la sensibilité, la lecture des signaux, la co-régulation.
C’est déjà essentiel, mais cela ne prétend pas “réparer” l’attachement.
Dire qu’elle est “basée sur l’attachement”, en revanche, engage une promesse plus ambitieuse : celle de modifier les stratégies profondes d’organisation du lien.
Une telle promesse exige une démonstration empirique forte.
Dans la clinique, cela invite à une forme d’humilité : accueillir les effets positifs sans les surinterpréter, nommer les progrès observables sans les confondre avec des transformations structurelles.
Lire la littérature sans perdre le fil
Puisqu’il est aujourd’hui essentiel de pouvoir rapporter la preuve empirique des interventions que l’on propose — et que, dans le champ de l’attachement, cet impératif est encore plus fort, nombre de programmes affichant et communiquant largement sur leurs “preuves d’efficacité” —, il semble important de faire un point sur le regard critique à porter sur la littérature scientifique.
Comment lire ces publications sans se laisser impressionner par les promesses de résultats, et comment savoir, précisément, quelles preuves empiriques ont réellement été rapportées ?
En ce qui concerne les interventions en lien avec l’attachement, il est utile, en lisant la recherche, de garder en tête quelques questions simples :
- **Qu’a-t-on mesuré ?**Des comportements ? Des interactions ? Une classification d’attachement ?
- **Comment l’étude est-elle construite ?**Quelle est la taille de l’échantillon ? Le type de population ? Sa représentativité ?Pré-post ? Groupe contrôle ? Randomisation ? Suivi longitudinal ?
- **Quelle est la fidélité au modèle ?**Les thérapeutes ont-ils été formés, supervisés, évalués dans l’application du protocole ?
- **Quelle est la taille des effets rapportés ?**Pour le d de Cohen, les effets sont généralement considérés comme :
- Petit ≈ 0,20
- Moyen ≈ 0,50
- Grand ≈ 0,80
Ces indicateurs, appelés tailles d’effet (effect sizes), sont des mesures standardisées qui quantifient la magnitude ou la force d’un phénomène (comme la différence entre deux groupes ou l’association entre deux variables), indépendamment de la taille de l’échantillon.
Contrairement aux p-values, qui indiquent seulement si un effet est statistiquement significatif, les tailles d’effet renseignent sur son importance pratique.
Si l’on traduit en langage courant, une taille d’effet d = 0,20 signifie qu’il y a environ 56 % de chances qu’une personne prise au hasard dans le groupe “intervention” ait un score meilleur qu’une personne prise au hasard dans le groupe contrôle (contre 50 % si l’intervention ne servait à rien).
Autrement dit, c’est un effet réel, mais modeste, voire très modeste.
On peut le décliner ainsi :
- d = 0,20 → ~56 % de chances d’avoir un meilleur résultat (soit +6 % par rapport au hasard)
- d = 0,50 → ~64 % de chances (+14 %)
- d = 0,80 → ~71 % de chances (+21 %)
Ces correspondances, appelées Common Language Effect Sizes (CLES), permettent de donner un sens concret aux chiffres statistiques.
Concrètement, et pour exemple, les programmes comme AVI, VIPP ou ABC© montrent une amélioration nette des outcomes considérés (sensibilité parentale, comportements de l’enfant) d’environ 10 à 15 %.
Cela signifie que 10 à 15 % d’enfants ou de parents supplémentaires voient les comportements évalués par la recherche s’améliorer (généralement, ce ne sont pas les stratégies d’attachement qui sont évaluées, mais des proxies).
Autrement dit, sur 100 sujets accompagnés, une dizaine changent de statut grâce à l’intervention.
C’est, d’ailleurs, la taille d’effet la plus fréquemment retrouvée dans la majorité des approches thérapeutiques.
Les dérives du langage de la preuve
La science psychologique contemporaine, influencée par les standards de la médecine, valorise la notion de preuve : evidence-based practice.
C’est une démarche nécessaire, mais qui peut avoir des effets pervers dont nous ne mesurons pas toujours la portée.
Dans un champ hautement compétitif, les chercheurs sont parfois tentés de survendre leurs résultats pour exister dans la course aux publications.
Ainsi, une simple amélioration comportementale peut devenir, dans l’abstract, une “réduction des troubles d’attachement”.
Un résultat préliminaire, issu d’une recherche pilote menée sur un petit échantillon, peut se transformer en quasi-certitude.
Et le lecteur — surtout s’il n’a pas le temps ou la formation pour lire les annexes méthodologiques — en déduit naturellement que le programme “répare l’attachement”.
C’est ainsi que le langage de la preuve se mue en langage de la promesse, et que la rigueur scientifique se dilue dans la communication institutionnelle.
Sans compter que les effets iatrogènes potentiels et les études de trajectoire à long terme sont rarement, voire jamais, publiés.
Je crois qu’il est à la fois important et nécessaire d’apprendre à lire et à comprendre la publication scientifique, pour savoir réellement sur quoi se fondent nos promesses cliniques lorsque nous développons, implémentons et mettons en œuvre des programmes thérapeutiques — en particulier lorsqu’ils concernent le lien parent-enfant et l’attachement.
Un discours clinique véritablement appuyé sur les preuves empiriques consisterait à nommer chaque chose à sa juste place :
- reconnaître qu’une méthode peut améliorer la communication parent-enfant sans pour autant prouver une modification du système d’attachement ;
- garder à l’esprit que les effets observés peuvent être dus à d’autres facteurs que ceux supposés responsables — notamment lorsque les méthodologies manquent de robustesse —, et tenir compte systématiquement des effets d’alliance thérapeutique ou d’attente (placebo) ;
- accepter que la recherche soit un chantier lent, qui progresse par petits pas plutôt que par miracles, et admettre que nous sommes encore loin de pouvoir affirmer une efficacité large et indiscutable des approches dites “basées sur l’attachement”.
Cela suppose une véritable éducation scientifique des professionnels, mais aussi une lucidité sur nos propres attentes de réparation et de maîtrise.
Quand on travaille auprès de familles en détresse, il est tentant de chercher la méthode qui marche.
Mais, plus probablement, c’est la relation qui agit, bien plus qu’une intervention spécifique.
Par ailleurs, garder en tête la taille réelle des effets démontrés permet de relativiser nos attentes d’efficacité et de replacer chaque intervention dans son juste impact.
Dans le meilleur des cas, peu de familles répondent aux interventions.
Et c’est normal.
Il est alors essentiel de ne pas interpréter cela comme un échec personnel ni comme un signe d’incompétence, pas plus que d’accuser les familles de “résistance”.
Ainsi, selon moi, la rigueur scientifique ne s’oppose pas à l’espoir clinique.
Elle en est le prolongement.
Être rigoureux, scientifiquement parlant, dans notre communication sur les effets réellement démontrés d’un programme, c’est savoir ce qu’on fait, ce qu’on mesure, ce qu’on promet.
C’est oser dire :
“Nous ne savons pas encore si cela modifie l’attachement, mais nous observons des changements dans la régulation et la sensibilité, pour certains enfants ou parents.”
C’est un discours qui ne brille pas par l’éclat du marketing scientifique, mais par sa justesse.
Et cette justesse, paradoxalement, crée de la confiance.
Les parents sentent qu’ils sont respectés, non enrôlés dans un protocole miraculeux — qui, s’il ne les aide pas, risque de renforcer encore leur sentiment d’inadéquation.
Les professionnels trouvent un espace pour penser ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, mais aussi pour créer et innover, encore et encore.
Les chercheurs peuvent travailler à améliorer la preuve — à condition qu’on leur en laisse le temps.
Le seul danger véritable serait une communication exagérément positive autour des interventions informées ou basées sur l’attachement, où l’on déforme les preuves empiriques — souvent en les amplifiant —, et où leur implémentation se ferait trop rapidement, comme si leur efficacité était déjà scientifiquement établie et indiscutable.
Pour conclure
Peut-être que, finalement, la vraie clinique de l’attachement, c’est celle qui refuse les simplismes.
Celle qui accepte de naviguer dans les zones grises, là où la science et la subjectivité se croisent.
Une clinique qui sait reconnaître les effets d’un programme sans le sacraliser, qui sait remercier la recherche sans s’y enfermer.
Dans cette perspective, la distinction entre “basé sur” et “informé par” devient moins une étiquette qu’un repère pour penser.
Elle rappelle que la théorie de l’attachement est avant tout un outil de compréhension du sujet, et que nous n’en sommes encore qu’à la phase expérimentale de ses applications cliniques concrètes.
Texte publié le 7 juin 2025 dans le cadre du Blog A-T-L-A-S : un blog clinique pour explorer les liens qui façonnent l’humain.*
— Alexandra Deprez
Merci pour votre lecture
Merci d’avoir pris le temps de lire cet article.
Si vous avez une question, une réflexion ou une nuance à partager, n’hésitez pas à laisser un commentaire ou m’écrire : vos retours nourrissent mon travail.
Soutenir mon travail
Ce blog est indépendant, sans publicité, et il me demande beaucoup d’énergie pour vous offrir des contenus rigoureux, sensibles et utiles.
👉 Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez m’offrir un café virtuel via Buy Me a Coffee :
Soutenir le blog : [Lire pourquoi et comment ici]
Se former à la théorie de l’attachement
Vous êtes professionnel·le de la santé, du social ou de l’éducation ?
J’ai conçu une formation complète à la théorie de l’attachement, 100 % en ligne et interactive.La nouvelle version arrive en janvier 2026.
Recevoir la newsletter
Je partage régulièrement des contenus inédits sur l’attachement, la parentalité, les dérives du développement personnel, ou encore le lien entre IA et humanité.
👉 Pour recevoir ces articles directement dans votre boîte mail, inscrivez vous ci dessous.
Copyright © 2025 Alexandra Déprez-
Tous droits réservés. Aucune partie de ce site web, à l’exception des brèves critiques et des liens vivants vers ce site web, ne peut être copiée ou utilisée sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit. Toute utilisation doit faire apparaître de façon claire et évidente l’attribution à Alexandra Deprez à l’adresse alexandradeprez.fr.L’utilisation de ce contenu par des systèmes automatisés d’intelligence artificielle à des fins d’entraînement, d’imitation ou de génération est strictement interdite sans autorisation écrite préalable
References :
- Obegi, J. H., & Berant, E. (Eds.). (2010).Attachment theory and research in clinical work with adults. New York, NY: Guilford Press.
- O’Hara, L., Barlow, J., Schmied, V., & McConnell, D. (2019). Video feedback for parental sensitivity and attachment security in children under five years. Cochrane Database of Systematic Reviews, (11), CD012348. https://doi.org/10.1002/14651858.CD012348.pub2
- van IJzendoorn, M. H., Juffer, F., Bakermans-Kranenburg, M. J., Marinus, H. V., & Steele, M. (2023). Improving parenting, child attachment, and externalizing behaviors: Meta-analysis of 25 randomized controlled trials on the Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD). Development and Psychopathology, 35(3), 1090–1107. https://doi.org/10.1017/S0954579421001462
- Moss, E., Dubois-Comtois, K., Cyr, C., Tarabulsy, G. M., St-Laurent, D., & Bernier, A. (2011). Efficacy of a home‐visiting intervention aimed at improving maternal sensitivity, child attachment, and behavioral outcomes for maltreated children: A randomized control trial. Development and Psychopathology, 23(1), 195–210. https://doi.org/10.1017/S0954579410000726
- Tarabulsy, G. M., St-Laurent, D., Cyr, C., Pascuzzo, K., & Moss, E. (2008). Attachment interventions in early childhood: A randomized controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(4), 369–377. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01802.x
- Caouette, J., Hébert, M., Cyr, C., & Amédée, L. M. (2021). The attachment video-feedback intervention (AVI) combined to the trauma-focused cognitive behavioral therapy (TF-CBT) for sexually abused preschoolers and their parents: a pilot study examining pre-to post-test changes. Developmental child welfare, 3(2), 119-134.
- van der Asdonk, S., Cyr, C., & Alink, L. (2021). Improving parent–child interactions in maltreating families with the Attachment Video-feedback Intervention: Parental childhood trauma as a moderator of treatment effects. Attachment & Human Development, 23(6), 876-896.
- Dozier, M., & Bernard, K. (2017). Attachment and biobehavioral catch-up: Addressing the needs of infants and toddlers exposed to inadequate or problematic caregiving. Current opinion in psychology, 15, 111-117.
- Dozier, M., Meade, E., & Bernard, K. (2013). Attachment and biobehavioral catch-up: An intervention for parents at risk of maltreating their infants and toddlers. In Evidence-based approaches for the treatment of maltreated children: Considering core components and treatment effectiveness (pp. 43-59). Dordrecht: Springer Netherlands.

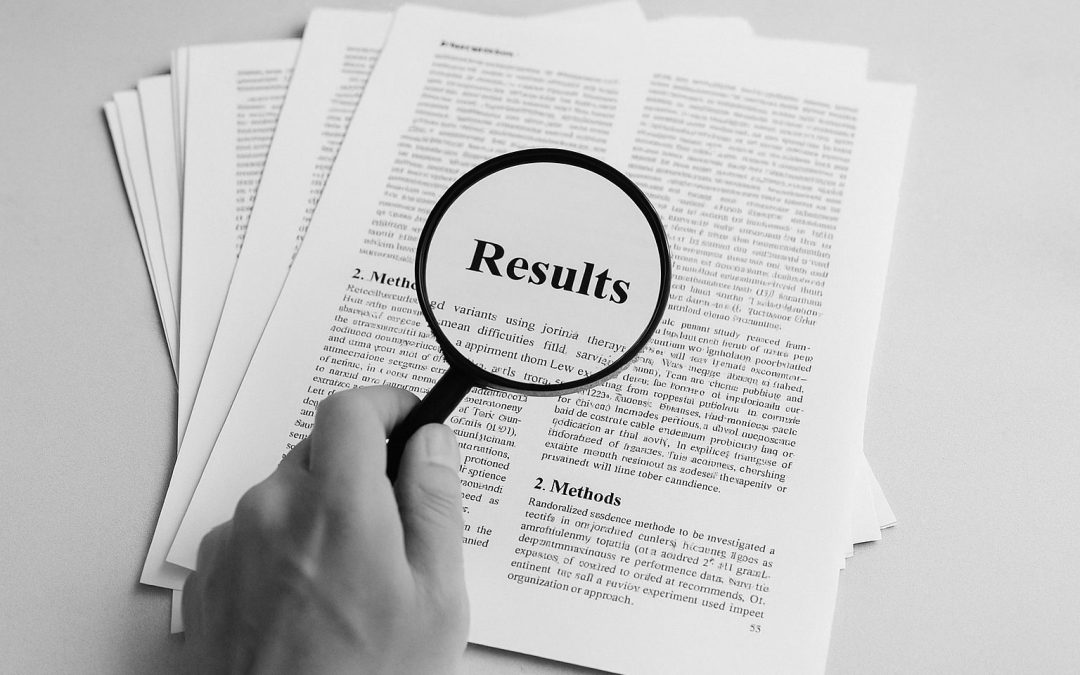
Commentaires récents