On ne se forme pas à la théorie de l’attachement en 2 jours. Ni en 6. Ni même en un an. Dans cet article, j’explique pourquoi le fast learning est dangereux dans ce domaine, et pourquoi il est temps de penser la formation autrement
Table des matières
Depuis plusieurs années, la théorie de l’attachement fait l’objet d’un intérêt grandissant dans les milieux cliniques, éducatifs et parentaux. C’est une bonne nouvelle. Mais cet engouement a aussi un revers : la multiplication de formations express, de webinaires tout-en-un, de livres de vulgarisation simplistes, de formations en ligne ou en présentiel de quelques heures qui promettent une compétence clinique réellement attachement-informée.
Ce qu’on appelle aujourd’hui le « fast learning », c’est une pédagogie condensée, orientée vers des objectifs rapides, présentée comme efficace parce que permettant un gain de temps. Ce type d’offre de formation devient un véritable danger quand elle concerne un champ aussi complexe, subtil et potentiellement impactant pour le sujet que la théorie de l’attachement (et pas seulement pour la théorie de l’attachement d’ailleurs). Je propose ici de faire le parallèle éclairant avec le phénomène de la fast fashion : produire vite, consommer vite, jeter vite. Au lieu de prendre le temps de fabriquer avec soin, on surproduit à bas coût pour satisfaire une demande éphémère, au prix de la qualité, de l’éthique et parfois de la dignité humaine. Le fast learning fonctionne de manière similaire : des formations prêt-à-penser, avec des formateurs qui ne sont pas toujours des experts du champ auquel ils forment, des contenus recyclés à partir de livres, sans méthodologie approfondie, des certifications express à coup de quiz qui prétendent valider une connaissance, pire, une compétence, mais ne demandent aucun engagement profond. Et tout comme la fast fashion nuit à l’environnement et aux travailleurs, le fast learning nuit au développement professionnel, à la pratique clinique, et au soin même, aux prises en charge que l’on prétend améliorer. Ce constat est particulièrement vrai pour les formations en santé mentale en général et, selon moi, particulièrement pour les formations à la théorie de l’attachement, puisque appliquer la théorie de l’attachement dans nos pratiques cliniques conduit à des interventions sur les relations significatives, aux fondements de la structuration psychique et de la santé mentale du sujet. Il semble qu’un minimum de précaution soit de mise.
Dans cet article, je veux détailler pourquoi le fast learning n’est pas seulement insuffisant dans ce domaine. Il est éthiquement risqué, scientifiquement réducteur et cliniquement délétère, et ne devrait pas exister en ce qui concerne la théorie de l’attachement.
1. La théorie de l’attachement est faussement simple
Il existe une représentation très répandue et insidieuse de la théorie de l’attachement : croire que c’est une théorie facile, qui explique beaucoup simplement, une théorie recette de cuisine en quelque sorte. Il suffirait de comprendre l’importance du lien, les quatre styles d’attachement, et hop c’est parti ! Cette représentation donne à croire que la compréhension de l’attachement serait accessible à tous en quelques étapes simples, qu’il suffirait d’appliquer une grille, de cocher quelques critères ou de reconnaître quelques comportements-clés pour être en mesure d’évaluer un lien, un parent, un enfant, voire une histoire de vie. Il suffit pour s’en rendre compte de faire une recherche sur YouTube avec les mots clés “théorie de l’attachement”, ou encore de consulter Google et de voir le nombre d’articles de blog plus ou moins sérieux qui présentent sans cesse les mêmes informations de base : Bowlby, Ainsworth, les quatre styles d’attachement, sans jamais approfondir.
Le pire, ce sont les livres de vulgarisation professionnelle. Je vous mets ici deux exemples récents qui, selon moi, sont particulièrement effrayants :
Attached: The New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find – and Keep – Love
Securely Attached: Transform Your Attachment Patterns into Loving, Lasting Romantic Relationships
C’est ainsi que l’on se retrouve sur les réseaux sociaux avec des “influenceurs attachement” qui s’auto-diagnostiquent leur propre style d’attachement, ou des coachs relationnels qui utilisent la sémantique de l’attachement pour expliquer à coups de reels pourquoi on se dispute dans un couple et comment changer son attachement.
Cette illusion de facilité d’accès est en fait perverse : elle appauvrit la théorie et la clinique qui en découle. Elle la rend prétendument utilisable mais en réalité dangereusement mal comprise. Alors qu’il s’agit d’une théorie complexe, dynamique, qui repose sur des décennies de recherche empirique et d’observation fine. Elle convoque des niveaux d’analyse multiples : neurobiologique, comportemental, affectif, narratif, symbolique et adaptatif. Elle implique l’acquisition d’une pensée clinique complexe, intégrée, et de savoir-faire méthodologiques rigoureux, surtout en ce qui concerne l’évaluation.
Les formations rapides empêchent, selon moi, de faire le vrai travail de formation : celui qui transforme le regard, qui apprend à corriger ses croyances, à repérer, comprendre, interpréter les signaux d’attachement, même les plus faibles et distordus. Celui qui apprend à penser le symptôme comme une tentative d’adaptation, pas comme un critère diagnostique de style d’attachement. Celui qui permet de comprendre que les apparences sont souvent trompeuses et que ce n’est pas si facile. La formation fast learning, rapide, de quelques heures ou jours, conduit à un usage trop stéréotypé des concepts, trop sûr de soi, trop déconnecté de la réalité du sujet en souffrance de lien. Elle produit des certitudes au lieu de nourrir une rigueur du doute, une clinique de l’humilité et, ce faisant, elle court le risque de produire des effets iatrogènes : abîmer les familles plutôt que de leur venir en aide.
D’un point de vue pédagogique, on se retrouve alors avec des professionnels qui pensent savoir mais ne savent pas, parce qu’ils n’ont pas intégré. C’est d’ailleurs pour cela que je commence toutes mes formations par une mise en évidence des représentations que les professionnels ont de la théorie de l’attachement, et que je challenge ces représentations.
Car comprendre et intégrer la théorie de l’attachement et ses apports méthodologiques et cliniques, ce n’est pas juste apprendre un vocabulaire, des concepts comme la sensibilité, la base de sécurité, les styles d’attachement et quelques données empiriques. C’est apprendre à voir autrement, à penser autrement, à être différemment, à entrer en lien avec les personnes qui ont le moins de capacité à entrer en lien. Et cela ne se fait ni vite, ni seul, ni sans effort de déconstruction du savoir pour reconstruire ensuite une autre façon d’être clinicien. D’autant que le système d’attachement du clinicien, son histoire plus ou moins sécure en termes d’attachement, est fondamentalement impliqué dans le processus. Nous ne sommes pas différents de nos patients sur ce point : nous sommes biaisés par notre propre histoire d’attachement.
Non. La théorie de l’attachement ne se résume pas à « le bébé est sécurisé ou insécurisé ». L’attachement ne s’observe pas directement, et encore moins chez l’adulte. Il ne se prête pas à des tests de type « quiz de style d’attachement en 10 questions ». Et il ne s’assimile pas en six heures de formation.
Pourquoi ?
Parce qu’elle nécessite un long temps d’intégration et de pratique accompagnée, comme n’importe quelle autre grande théorie du fonctionnement humain. Personne ne se formerait à la systémique ou aux thérapies comportementales et cognitives en quelques jours.
2. Le fast learning produit des certitudes, pas des compétences
Le fast learning en attachement produit souvent des professionnels qui parlent très bien des concepts (encore que j’ai plus d’une fois eu des apprenants formés à l’attachement qui ne savaient pas définir concrètement des notions de base), mais qui ne savent pas les articuler avec la clinique, l’observation et les prises en charge. Ils ne les maîtrisent pas dans la complexité du terrain. Ils répètent des phrases apprises, utilisent des grilles de lecture préétablies, plaquent des diagnostics « d’attachement ».
L’effet est redoutable : cela donne une illusion de compétence.
Et là est le vrai danger. Une illusion de compétence sur un thème aussi cliniquement sensible que l’attachement peut avoir des conséquences graves :
- Erreurs d’évaluation de la souffrance infantile et parentale, de la difficulté du lien
- Méconnaissance des contextes de risque
- Simplification abusive de profils complexes
- Interprétations figées, parfois stigmatisantes
- Réponses inadaptées en clinique ou en protection de l’enfance
Ce n’est pas une question d’incompétence ou de mauvaise volonté des professionnels. C’est une question de pédagogie, de processus d’implémentation du savoir scientifique, de structure d’apprentissage. C’est aussi la difficulté à articuler la demande de formation et la production d’une offre de formation adaptée. Ce constat, je le fais tous les jours dans les formations, les supervisions, et dans la communauté pédagogique et réflexive que j’anime.
3. L’attachement : une méta-théorie à intégration lente dans la pratique
La théorie de l’attachement est un savoir transformant. C’est une transformation du regard, de la lecture du monde, de soi, de soi en lien, de l’autre, de l’autre en lien. C’est un changement dans le traitement de l’information émotionnelle, cognitive et donc relationnelle dans le cerveau du clinicien, pour qu’il puisse comprendre et accompagner des sujets/patients en insécurité depuis parfois le jour de leur naissance.
Or, on ne transforme pas un regard à coups de slides et de trois vidéos de situation étrange de population normative.
- Il faut du temps pour observer, se tromper, revenir en arrière, affiner, comparer. C’est même une dimension assez frustrante de la formation en attachement, si j’en crois ma propre expérience 😊.
- Il faut du temps pour apprendre à identifier et comprendre la dimension adaptative fonctionnelle dans le lien, les transformations du traitement de l’information qui se cachent derrière les comportements du sujet, même si, au premier abord, ces comportements apparaissent comme autant de symptômes psychopathologiques.
- Il faut du temps pour identifier et comprendre les comportements qui ne prennent sens que dans leur fonction adaptative systémique et relationnelle.
- Il faut du temps pour comprendre qu’il est possible d’observer les mêmes comportements relationnels sans que cela signifie que l’enfant, ou le sujet, utilise la même stratégie d’attachement ; que c’est la fonction relationnelle avec la figure d’attachement qui va donner sens au comportement et donc à la stratégie.
- Il faut du temps pour se détacher d’une lecture pathologisante de l’attachement insécure et pour transitionner d’une évaluation par critères vers une formulation de la fonction relationnelle.
- Il faut du temps pour comprendre que l’attachement est une synapse sociale, qu’il fait jonction entre le monde interne du sujet, sa génétique, sa neurophysiologie et son monde externe (son époque, sa culture), celui dans lequel il devra apprendre à survivre.
- Il faut du temps pour comprendre que cet apprentissage se réalise au sein des relations significatives vitales, pour le meilleur ou pour le pire.
- Il faut du temps pour comprendre puis mettre en application minutieusement ce que cela implique pour soulager le sujet de sa souffrance, quand cela est possible, et lui permettre de développer d’autres stratégies d’attachement.
- Il faut du temps pour comprendre, au-delà de la notion de sensibilité, ce qui organise le comportement parental et donc l’attachement de l’enfant.
Ce temps ne peut pas être court-circuité. Il n’y a pas de raccourci possible.
Le fast learning, ce sont des formations raccourcies qui espèrent court-circuiter le temps nécessaire à la maturation du clinicien. Elles laissent intactes la structure de pensée, les défauts d’observation et d’interprétation du comportement, les méthodes d’action clinique déjà assimilées, et ne donnent pas le temps de penser les frictions entre terrain et théorie, ou entre différentes théories.
Se former à l’attachement est un processus de maturation autant que d’apprentissage, et cela ne peut pas être compressé dans un format rapide sans en altérer profondément le sens et en réduire considérablement la portée.
4. Vulgariser trop vite trahit la science
Beaucoup de professionnels informés de la théorie de l’attachement par leurs propres formations sentent bien les apports de cette théorie à la clinique. Mais il y a un monde entre avoir appris pour soi et pouvoir transmettre : un monde d’expertise, un monde d’entraînement méthodologique, un monde de savoirs théoriques articulés avec précision, un monde d’expérience clinique.
Ces professionnels sont bien intentionnés, mais souvent peu formés, et de surcroît poussés par des contraintes d’un marché de la formation qui ne perçoit pas l’exigence d’une formation approfondie, et qui, plus encore, a du mal à la financer. En voulant rendre la théorie de l’attachement plus accessible cliniquement, financièrement, temporellement, on sacrifie la rigueur et on propose des formations courtes, parfois simplement centrées sur un aspect unique. Mais dans le format « express », on perd ce qui fait la force et la subtilité du modèle.
Voici quelques exemples de trahisons conceptuelles courantes :
- Réduire l’attachement à quatre styles (sécure, anxieux, évitant, désorganisé), en faire des traits de personnalité ou des étiquettes diagnostiques, sans jamais avoir appris une méthodologie fiable d’évaluation.
- Prétendre qu’on peut auto-évaluer son attachement facilement, parfois même avec des tests en ligne.
- Confondre comportements d’attachement et stratégies internes d’adaptation : croire qu’il suffit de cocher la présence ou l’absence de certains comportements pour savoir de quoi il retourne en termes d’attachement.
- Extrapoler de la clinique adulte à la clinique du bébé, et inversement.
Ces raccourcis ne sont pas neutres. Ils biaisent les interventions. Ils créent des malentendus durables — l’un des plus répandus étant l’inflation de la notion de “troubles de l’attachement”. Ils promeuvent un flou conceptuel et clinique. Ils produisent l’effet inverse de celui recherché : renforcer les systèmes de défense plutôt que de favoriser une véritable ouverture, générer des effets délétères.
5. L’enjeu n’est pas de « former plus vite », mais de « former juste »
D’une certaine façon, on se trompe d’objectif en voulant former vite, et la formation digitale contribue à cette fausse route. Il existe un mythe selon lequel le digital doit accélérer l’apprentissage. C’est une erreur de perspective. Le digital peut faciliter l’accès, séquencer les contenus, offrir de la flexibilité. Mais il ne peut pas abolir le temps de maturation, ni le coût réel des formations.
Vouloir transformer un modèle aussi riche que la théorie de l’attachement en une formation en ligne de 2 jours, c’est comme vouloir apprendre à jouer du violon en regardant un tutoriel. On peut comprendre l’idée. On ne maîtrisera jamais le geste.
Former juste, c’est créer un cadre d’apprentissage qui respecte :
- La complexité du modèle
- Le rythme d’intégration de l’apprenant, sa zone proximale de développement (on ne forme pas à l’attachement de la même manière selon la formation initiale des apprenants, leur niveau de qualification, leurs besoins concrets en termes de savoir et de savoir-faire)
- Le type de populations cliniques concernées par les applications cliniques qui vont en être faites
Il convient donc de penser les processus pédagogiques. D’accepter que le savoir cliniquement utile n’est pas un savoir livresque empilé au-dessus des autres, mais une transformation de ce que l’on croyait savoir, un changement de façon d’analyser, de comprendre, d’agir. Ce savoir doit être confronté à la réalité du terrain, monitoré et modifié au besoin. Ce travail prend du temps, des ressources, de l’énergie.
Mais si l’on accepte cela, alors les résultats de l’implémentation de la théorie de l’attachement dans les pratiques cliniques tiendront leurs promesses.
6. Former les formateurs : une exigence encore plus grande
Former à la théorie de l’attachement exige aussi de se poser la question : qui forme les formateurs ?
Car former à la théorie de l’attachement, ce n’est pas seulement transmettre un savoir. C’est aussi incarner un niveau d’intégration suffisant pour pouvoir accompagner d’autres professionnels dans ce processus. Or, trop souvent, oon voit des formateurs se présenter comme experts alors qu’ils n’ont pas de formation longue, pas de connaissance ni des textes ni des outils fondateurs.
Pour ma part, cela fait près de 30 ans que j’étudie la théorie de l’attachement. Je continue à me former directement auprès de Patricia Crittenden (elle-même formée par Bowlby et Ainsworth), je suis engagée dans le programme de fellowship de l’IASA (International Association for the Study of Attachment), et je bénéficie d’une supervision régulière par un expert du DMM. Je travaille aussi à maîtriser différents instruments (AAI, PAA, CARE-Index, ADBB, SSP) qui demandent une pratique continue et exigeante.
Je ne suis pas la seule à maintenir ce niveau d’engagement, mais nous sommes encore peu nombreux à poursuivre ce type de formation approfondie. Et c’est bien là le point : former à l’attachement suppose d’accepter de rester soi-même en apprentissage permanent. On ne transmet pas seulement des contenus, on transmet une posture, une rigueur, un regard. La formation des formateurs devrait donc être pensée avec la même exigence que celle attendue des cliniciens eux-mêmes.
7. Former est aussi un enjeu politique, éthique… et économique
Pourquoi le fast learning se développe-t-il, alors qu’il est manifestement inadéquat dans des champs comme la théorie de l’attachement ? Parce qu’il répond à une demande : aller vite, être compétent sans effort, obtenir une certification pour valoriser un CV, “consommer” de la formation.
Mais cette demande ne vient pas de nulle part. Elle est le fruit de logiques institutionnelles et financières très concrètes.
En France, le système de financement de la formation continue pousse parfois à réduire les formats, à « remplir des cases », à rentrer dans des enveloppes horaires artificielles pour être éligible aux prises en charge (DPC, OPCO, CPF, etc.). Il faut souvent promettre des durées courtes, des objectifs clairs, des acquis mesurables immédiatement, pour rentrer dans les grilles d’évaluation — ce qui a été aggravé par la réforme Qualiopi. Or, tout cela est à rebours de ce que demande une véritable formation clinique sur l’attachement (et, plus largement, toute formation clinique approfondie).
Apprendre à penser la complexité, à voir l’implicite, à tolérer l’ambiguïté, cela prend du temps. Cela ne rentre pas dans une logique de « compétences clés » évaluables en fin de session. Cela exige même l’inverse : du déséquilibre, du doute, de l’exploration, de la réflexion.
Il est urgent d’ouvrir un débat sur le coût réel d’une formation exigeante. Former bien prend du temps, mobilise de l’accompagnement, nécessite des supports de qualité, une posture pédagogique rigoureuse et un suivi. Cela a un coût. Et ce coût est légitime, parce que les enjeux sont majeurs : il ne s’agit pas de vendre une méthode, mais de former un regard, une éthique d’intervention, une sensibilité clinique.
Former vite et à bas coût peut même être considéré comme une perte d’argent, un véritable gâchis : rien n’est vraiment maîtrisé, pire, le peu qui est assimilé et utilisé l’est à mauvais escient et crée des dégâts.
Et que dire des formations “gratuites” — vidéos YouTube ou autres produits d’appel ? Il faut bien comprendre que si c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit, et que ce qui est donné n’a généralement pas vraiment de valeur. Les contenus à forte valeur ne sont pas donnés gratuitement, sauf s’ils sont massivement subventionnés par des fonds publics (et donc payés par les impôts).
Je pense que nous avons une responsabilité collective : refuser la marchandisation du savoir clinique. Ne pas faire de l’attachement, ou de toute autre formation aussi transformante, un produit d’appel. Refuser de transformer les stratégies de survie psychique en slides PowerPoint. Et refuser, surtout, de céder à la logique du « moins cher, plus vite, plus visible » lorsqu’il s’agit de former ceux qui auront entre leurs mains la compréhension et le travail des liens les plus fragiles.
En conclusion : une autre pédagogie est possible
Il est temps de redonner au temps d’apprendre sa place.
C’est précisément la vocation de L’École d’Application Clinique de l’Attachement (LÉACA) : Riche de ma formation intense et de mon expérience clinique, je propose une alternative exigeante aux formations superficielles ou trop théoriques, en offrant une montée en compétence réelle, progressive, tout en permettant des applications concrètes mais circonscrites à toutes les étapes du développement professionnel. Une formation qui transforme le regard et la posture clinique.
LÉACA s’appuie sur quatre piliers :
- Des savoirs fondamentaux, via une formation théorique approfondie, informée du DMM, sans simplification, technique, mise à jour, qui permet de lutter contre le flou conceptuel et la vulgarisation dangereuse.
- Des savoir-faire cliniques, grâce à l’observation, aux techniques d’entretien attachement-informées et à des outils validés (ADBB, CARE-Index, et d’autres à venir).
- Des savoir-être réflexifs, cultivés dans une communauté pédagogique et réflexive qui accompagne dans la durée, soutient la pratique et favorise l’intégration progressive : deux rencontres mensuelles, un espace d’échanges continu, une charte éthique partagée. Tout est pensé pour offrir un climat de rigueur et de soutien mutuel, loin de l’isolement professionnel. Les retours des participants sont clairs : participer à cette communauté aide à ne pas s’épuiser, à maintenir vivante sa réflexion clinique, à continuer la veille scientifique et à incarner une pratique réellement attachement-informée.
- Un accompagnement au changement de regard et de posture, par un processus de certification privée (non obligatoire mais recommandé), exigeant mais efficace.
Car même les meilleures formations, aussi solides soient-elles, ne suffisent pas à elles seules à transformer la pratique. C’est dans l’après-coup, au contact du réel, que surgissent les doutes, les questions, les dilemmes cliniques. C’est pour cela que, même après la fin des modules, nous proposons de rester en lien dans la communauté pour continuer à travailler à la montée en compétence et à l’intégration des apports de la théorie de l’attachement en clinique, accompagné des autres professionnels formés et de l’expert.
C’est là toute la différence avec le fast learning.
Texte publié le 11 septembre 2025 dans le cadre du Blog A-T-L-A-S : un blog clinique pour explorer les liens qui façonnent l’humain.*
— Alexandra Deprez
Merci pour votre lecture
Merci d’avoir pris le temps de lire cet article.
Si vous avez une question, une réflexion ou une nuance à partager, n’hésitez pas à laisser un commentaire ou m’écrire : vos retours nourrissent mon travail.
Soutenir mon travail
Ce blog est indépendant, sans publicité, et il me demande beaucoup d’énergie pour vous offrir des contenus rigoureux, sensibles et utiles.
👉 Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez m’offrir un café virtuel via Buy Me a Coffee :
Soutenir le blog : [Lire pourquoi et comment ici]
Recevoir la newsletter
Je partage régulièrement des contenus inédits sur l’attachement, la parentalité, les dérives du développement personnel, ou encore le lien entre IA et humanité.
👉 Pour recevoir ces articles directement dans votre boîte mail, inscrivez vous ci dessous.
Se former à la théorie de l’attachement
Vous êtes professionnel·le de la santé, du social ou de l’éducation ?
J’ai conçu une formation complète à la théorie de l’attachement, 100 % en ligne et interactive. La nouvelle version arrive en janvier 2026.
Copyright © 2025 Alexandra Déprez-
Tous droits réservés. Aucune partie de ce site web, à l’exception des brèves critiques et des liens vivants vers ce site web, ne peut être copiée ou utilisée sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit. Toute utilisation doit faire apparaître de façon claire et évidente l’attribution à Alexandra Deprez à l’adresse alexandradeprez.fr.L’utilisation de ce contenu par des systèmes automatisés d’intelligence artificielle à des fins d’entraînement, d’imitation ou de génération est strictement interdite sans autorisation écrite préalable

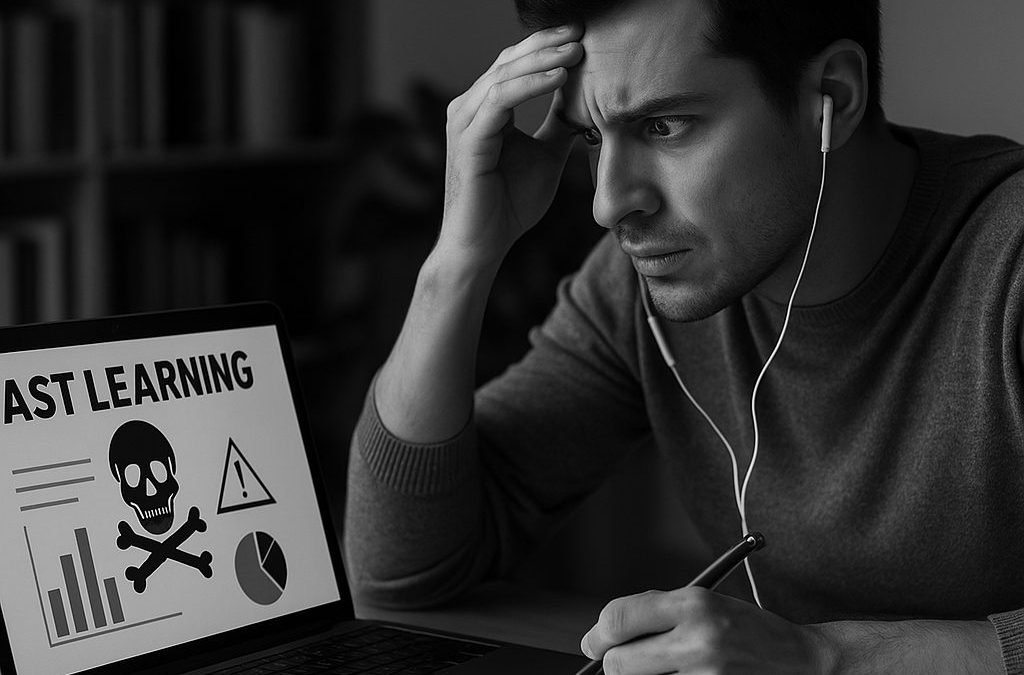
Commentaires récents