Table des matières
Introduction :
Quand on écrit un blog, il faut parfois sortir de sa bibliothèque et aller voir ce qui circule sur Internet au sujet de ce dont on parle, ce à quoi on réfléchit et on écrit.
Dans mon cas, il s’agit de la théorie de l’attachement, son implémentation sur le terrain, ses applications cliniques, et plus largement de la manière dont elle est transmise au grand public.
Et pour être franche, ce que j’y découvre me désole.
Le mot attachement est partout, avec des publications qui vont du meilleur au pire, mais avec souvent, hélas, beaucoup de confusions, simplifications, voire des erreurs.
Sur Instagram ou même sur LinkedIn, on voit défiler des citations, des “posters pédagogiques”, des “slides de vulgarisation”, voire des formules toutes faites pour “guérir son attachement”, des personnes qui s’auto-déclarent évitants, autonomes, anxieux et revendiquent une forme de reconnaissance, du moins c’est l’impression que j’en ai.
Dans le meilleur des cas, ces messages simplifient à l’extrême une théorie complexe ; dans le pire, ils la déforment jusqu’à en faire une morale déguisée ou les posts sont carrément faux.
Beaucoup de pseudo-experts donc. Je parle de “pseudo-experts” pas par mépris, mais parce que je doute que beaucoup aient une formation approfondie ou une compréhension rigoureuse de ce qu’ils diffusent parce que les formations approfondies à la théorie de l’attachement sont rares, et très peu accessibles en français.
Il résulte de tout ceci un flou massif, où chacun parle d’attachement mais plus personne ne sait si c’est bien de la théorie de Bowlby et de ses évolutions dont on parle.
Et si moi, qui travaille sur le sujet depuis plus de vingt ans, j’ai parfois du mal à m’y retrouver, imaginez pour les lecteurs, les étudiants, les cliniciens qui souhaitent comprendre…
En cherchant à mettre de l’ordre dans ce brouillard, je suis tombée sur un article remarquable de clarté :
“Six attachment discourses: convergence, divergence and relay” (Duschinsky et al., 2021).
Ce texte m’a permis de comprendre pourquoi nous ne parlons pas tous de la même “théorie de l’attachement”, et d’identifier les différents discours qui se sont développés autour d’elle, chacun avec son histoire, ses auteurs, son langage et ses angles morts.
Dans cet article, je vous propose donc trois étapes :
— D’abord, une présentation pédagogique des six discours décrits par Duschinsky et de leurs logiques respectives.
— Ensuite, une mise en perspective du positionnement de Patricia Crittenden, que je considère mal situé dans ce cadre — car c’est précisément là que je me situe moi-même : à l’intersection du développement, de la protection de l’enfance et de la clinique.
— Enfin, un petit guide réflexif qui vous aidera, si vous le souhaitez, à situer votre propre discours sur l’attachement, à repérer d’où vous parlez, quelles sont vos références … ou pas.
I — D’où vient la confusion ?
Le mot attachement semble aller de soi. Tout le monde croit savoir ce qu’il désigne : un lien, un besoin, un style de relation, une sécurité ou son absence.
Pourtant, quand on regarde de plus près, ce mot ne renvoie pas au même sujet selon le champ d’application dans lequel on l’utilise.
Un chercheur, un clinicien, un travailleur social ou un influenceur sur Instagram ne parlent en fait pas tout à fait de la même chose, même s’ils emploient le même vocabulaire.
Cette divergence non reconnue est un problème parce que cela crée des malentendus, voire des frictions, ou un désintérêt pour une théorie pourtant passionnante.
Des mots comme relation d’attachement, (base de) sécurité, attachement anxieux, évitant, désorganisé circulent d’un domaine à l’autre comme s’ils gardaient leur sens d’origine, alors qu’ils se sont reconfigurés à chaque aiguillage scientifique.
De ce fait, les frontières entre l’utilisation scientifique, clinique, de prévention ou d’opinion de la théorie se brouillent, jusqu’à produire un langage hybride, flou et inefficace pour penser le sujet et communiquer.
La cause de cette sémantique “attachementiste” devenue imprécise n’est pas seulement due à la vulgarisation massive et rapide, mais reflète aussi une fragmentation structurelle de la théorie de l’attachement elle-même, qui s’est développée dans des contextes très différents : la psychologie du développement, la psychothérapie, la psychiatrie, la protection de l’enfance, les politiques publiques, et désormais les réseaux sociaux et les médias.
Chacun de ces contextes a sélectionné, adapté et parfois simplifié la théorie pour la rendre compatible avec ses propres besoins, quitte à en réduire la cohérence initiale.
C’est précisément ce que Duschinsky et ses collègues ont mis en évidence dans leur article : **la théorie de l’attachement ne forme plus aujourd’hui un corps unifié, mais un ensemble de discours distincts, partiellement autonomes et parfois en tension.**Ces discours se répondent, se chevauchent et se relayent, chacun avec ses propres objectifs, méthodes et publics. (Duschinsky et al., 2021, p. 2–4)
Pour clarifier cette complexité, Duschinsky propose quatre questions fondamentales à se poser chaque fois qu’on parle d’attachement :
— Quel est le contexte ?
S’agit-il d’un cadre scientifique, clinique, éducatif, politique, médiatique ?
— Que demande ce contexte au concept ?
A-t-il besoin d’un outil de recherche, d’une clé de compréhension de soi, d’un diagnostic, d’un langage de communication ou d’un cadre thérapeutique ?
— Comment le discours ajuste-t-il le concept à ses besoins ?
Qu’est-ce qu’il met en avant, simplifie, élimine ou détourne pour faire atteindre la théorie aux objectifs du contexte dans lequel elle est convoquée ?
— Où sont les points de relais entre les domaines ? Y en a-t-il ?
Autrement dit : comment les idées circulent-elles d’un champ à l’autre, et que deviennent-elles en chemin ?
Ces quatre questions sont simples, mais elles permettent de penser la circulation des idées, d’identifier l’angle à partir duquel on parle de l’attachement et de limiter les effets délétères d’une communication floue.
Elles révèlent que le désordre apparent des discours sur l’attachement n’est pas que dû à une faible maîtrise de la théorie, mais à une diversité de fonctions et de registres d’usage du même mot qui, en fait, ne recouvrent ni les mêmes réalités cliniques, ni les mêmes usages.
Comprendre les différents discours sur la théorie de l’attachement, c’est reprendre pouvoir sur les mots et leurs concepts. C’est s’équiper d’outils de discernement pour mieux penser, mieux transmettre, et mieux travailler ensemble.
Et sur le terrain, c’est aider une équipe, une institution ou un professionnel à choisir les ressources, les formations et les filiations théoriques qui soutiendront vraiment leur pratique.
C’est ce que nous allons explorer maintenant, à travers les six grands discours identifiés par Duschinsky et ses collègues.
II. Les six discours de l’attachement : six façons de comprendre et dire le lien humain
1. L’analyse de Duschinsky
Pour comprendre comment la théorie de l’attachement s’est fragmentée, Duschinsky et ses collègues ont mené un travail de cartographie historique et épistémologique dans le cadre du projet Cornerstones (Université de Cambridge).
Leur objectif était d’examiner comment le même concept scientifique d’attachement a été approprié, reformulé et réutilisé dans différents contextes professionnels et/ou de recherche, parfois sans lien entre eux.
La démarche de ces auteurs s’inspire de la sociologie des discours : plutôt que de juger les usages, ils cherchent à comprendre les fonctions que chaque discours attribue au concept selon ses besoins.
**Il ne s’agit donc pas de savoir qui “a raison”, mais de comprendre comment et pourquoi chaque domaine a produit sa propre version de la théorie.**Cette étude met en lumière des discours sur l’attachement partiellement autonomes, chacun avec ses méthodes, ses logiques, ses auteurs clés et ses publics.
2. Les six discours de l’attachement
2.1 Le discours populaire : l’attachement vulgarisé, simplifié, appliqué généralement à la parentalité
C’est le plus visible aujourd’hui, celui des livres de parentalité, des podcasts, des publications Instagram, et parfois même des formations de base en direction des professionnels de la petite enfance notamment.
Il repose sur une idée simple : comprendre l’attachement, c’est comprendre comment aimer mieux ses enfants. C’est un discours sur l’attachement qui est lié avec celui de l’éducation positive.
C’est aussi, dans ses applications plus sérieuses, le discours qui s’empare de la prévention précoce.
Historiquement, il repose essentiellement sur les idées de Bowlby (1951) selon lesquelles l’attachement est un besoin primaire et universel. Ce discours popularise des notions scientifiques complexes (sécurité, désorganisation, base de sécurité, etc.) mais au prix d’une simplification extrême qui peut s’avérer contre-productive cliniquement. C’est un discours qui s’est émancipé de toute contrainte méthodologique et scientifique. On s’appuie sur des métaphores, des exemples et qui utilise les preuves empiriques souvent en déformant les résultats et en leur donnant plus de poids qu’ils n’en ont.
La fonction de ce discours est de permettre au sujet de « se comprendre », de comprendre comment il fonctionne relationnellement en fonction de son histoire, comment fonctionne l’enfant. C’est donc une fonction narrative et apaisante d’une certaine manière, car elle offre une grille de lecture de soi en lien avec les autres simplifiée.
C’est ce que je qualifie, péjorativement je le reconnais, de discours sur la théorie de l’attachement “recette de cuisine”. Une théorie simple, quatre catégories qui permettent d’expliquer rapidement la complexité du lien humain quitte à sacrifier la nuance scientifique. Chacun peut s’identifier dans une des catégories, ou classer son enfant dans une des catégories, être rassuré par cette « étiquette » qui donne une illusion de compréhension.
Ce type de discours porte le risque de transformer la théorie en une théorie où les concepts deviennent des étiquettes identitaires, ou pire morales, comme je peux le voir passer parfois dans des posts sur les réseaux sociaux, où, par exemple, avoir un attachement évitant serait presque un crime, par exemple.
En France, le discours populaire sur l’attachement s’est surtout incarné à travers des figures médiatiques comme Boris Cyrulnik, Isabelle Filliozat ou Catherine Gueguen, Joanne Lemieux, qui ont contribué à faire connaître le concept au grand public pour le meilleur. C’est aussi le discours des tenants de l’ «attachment parenting » sensé vous expliquer comment agir en tant que parent pour avoir des enfants sécurise. Enfin, c’est le discours d’ un certain nombre d’influenceurs auto-proclamés spécialistes de l’attachement sur les réseaux sociaux.
2.2 Le discours développemental : la science des patterns
C’est le socle historique et méthodologique de la théorie de l’attachement.
Né dans les années 1970 autour d’Ainsworth, Main, leurs collaborateurs et étudiants. Il repose sur une approche empirique et observationnelle du bébé et de l’enfant, et plus tard de l’adulte, mais généralement de l’adulte parent sur des populations normatives.
Le cœur de cette approche est de documenter les comportements/représentations d’attachement à travers des protocoles standardisés comme la Strange Situation Procedure (SSP), puis la Adult Attachment Interview (AAI), et de faire des études développementales à court, moyen ou long terme.
Ce discours **vise à décrire et prédire les patterns d’attachement, leurs trajectoires développementales et leurs liens avec le fonctionnement psychique du sujet, sa parentalité ou la psychopathologie.**Sa force est dans la rigueur méthodologique, la cohérence cumulative des données, la clarté conceptuelle. C’est une approche fondamentalement basée sur la méthode scientifique. Mais cette force est aussi sa limite, car le modèle reste souvent enfermé dans des laboratoires de recherche, avec une transmission des outils de mentor à élève, sans rechercher l’implémentation clinique. C’est en quelque sorte l’axe de la recherche fondamentale de la théorie de l’attachement.
2.3 Le discours social-psychologique : la mesure des styles d’attachement, le couple et le passage d’un attachement inconscient à un attachement conscientisé
À partir des années 1980, la psychologie sociale s’empare du concept d’attachement adulte, avec les travaux de Hazan et Shaver (1987) puis Brennan, Mikulincer et Fraley.
Leur objectif est de rendre le modèle accessible à grande échelle, dans des recherches quantitatives sur la personnalité et les relations amoureuses.
Ici, l’attachement n’est plus observé, il est déclaré. Les individus s’auto-évaluent à l’aide de questionnaires comme l’ECR (Experiences in Close Relationships) permettant d’obtenir un classement du sujet sur deux dimensions principales : anxiété et évitement en termes d’attachement.
Ce discours a eu le mérite d’ouvrir la recherche à des milliers de sujets, mais il a aussi déraciné la théorie de son ancrage développemental et de sa rigueur méthodologique et observationnelle, une théorie un peu plus hors sol conceptuellement en quelque sorte.
Ce discours repose sur un modèle cognitif et relationnel, et conscient de l’attachement, plutôt que sur le comportement et les traces inconscientes de ce qui a été appris dans les premières années du développement.
Le postulat serait que ce qui est déclaré est en lien avec ce qui a été développé.
Le résultat, c’est que l’attachement devient un style relationnel, voire trait de personnalité, plutôt qu’un pattern interactionnel, un modèle interne opérant inconscient, une stratégie adaptative. La vulgarisation de ce discours conduit à une utilisation de la théorie de l’attachement dans le coaching relationnel et amoureux sans s’offusquer aucunement de l’aspect caricatural, performatif et parfois stigmatisant de l’utilisation premier degré de ces concepts, qui sont finalement très éloignés de la conception de l’attachement dans le discours développemental.
2.4 Le discours psychothérapeutique : la réparation / rendre plus sécure
À partir des années 1990, la théorie de l’attachement pénètre massivement la psychothérapie, grâce à Holmes, Schore, Fonagy, Johnson, Steele et d’autres.
Ce discours utilise l’attachement comme métaphore intégratrice pour penser la relation thérapeutique, le trauma développemental, la reconstruction du sentiment de sécurité. C’est dans ce discours que l’on parle le plus souvent de réparer l’attachement, qui est perçu comme dysfonctionnel dès lors qu’il n’est pas sécure.
Sa fonction est intégrative. L’attachement permet de donner un langage commun à des thérapeutes d’approches différentes.
La faiblesse ici, c’est la pathologisation de processus développementaux qui sont avant tout des adaptations de survie.
Les concepts deviennent des mots-valises performatifs. C’est à dire que le mot réalise lui même ce qu’il énonce. Parce qu’on me dit sécure ou désorganisé je vais m’identifier à cette étiquette et agir en conséquence, penser mon fonctionnement à partir de cette étiquette qui semble faire sens même si je n’ai pas reçu d’évaluation approfondie. Les concept d’attachement deviennent alors comme autant d’étiquettes diagnostiques parfois auto-explicatives. La sécurité de l’attachement est le saint graal à atteindre.
2.5 Le discours psychiatrique : l’attachement comme trouble
Le champ psychiatrique s’est intéressé à l’attachement à partir du DSM-III (1980), en créant les diagnostics de Reactive Attachment Disorder (RAD) et Disinhibited Social Engagement Disorder (DSED).
Ici, l’attachement devient catégorie nosographique, définie par des critères comportementaux (inhibition, évitement, familiarité excessive, etc.).
Ce discours a une fonction pragmatique, qui serait de repérer les effets des carences relationnelles précoces et d’orienter les prises en charge.
Mais, outre le fait que la validation scientifique de ces diagnostics ne fait pas encore l’objet d’un consensus, cette approche porte en elle le risque de pathologiser des manifestations comportementales sans chercher à comprendre les processus adaptatifs sous-jacents et la question de l’environnement qui organise ces formes d’attachement. Il repose sur une lecture du comportement du sujet comme dysfonctionnel et peut conduire à faire l’économie de comprendre le sens des comportements extrêmes d’attachement. Par ailleurs, la notion de troubles de l’attachement est généralement très mal connu et confondu avec toutes formes de stratégies d’attachement anxieuses « dérangeante » pour la classe, l’institution…
2.6 Le discours du travail social et de la protection de l’enfance : l’attachement comme évaluation de la compétence parentale au service de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant
Dernier grand registre identifié par Duschinsky : celui de la protection de l’enfance, du travail social et des politiques publiques.
C’est le discours le plus chargé de conséquences pratiques selon moi : il détermine parfois des décisions de placement, de garde ou de séparation. Les pays anglo-saxons étant plus avancé dans ce domaine, pour le meilleur et pour le pire, que les pays francophone.
Issu de la prise de conscience des effets de la carence de soins précoces et de la séparation qu’a générée le travail de Bowlby, il a ensuite recruté les méthodes développées par les développementalistes comme moyen de rendre compte du risque et d’aider à la prise de décisions en protection de l’enfance.
Dans ce discours, le recours à la notion de désorganisation de l’attachement devient marqueur de risque est central et la sensibilité parentale un critère de compétence parentale observable.
L’attachement y devient donc un outil d’évaluation de la qualité du lien, de la parentalité et du risque. Les auteurs les plus connus étant David Shemmings & Yvonne Shemmings, David Howe. En France, plusieurs documents institutionnels de formation (notamment ceux du CNFPT ou de l’ONPE) présentent la désorganisation comme une notion clé pour comprendre la clinique du placement et de la protection de l’enfance. Il ne s’agit pas d’auteurs plaidant pour en faire un critère décisionnel, mais de supports de formation qui, faute de précision sur les limites d’interprétation, peuvent être sur-interprétés sur le terrain. Sans la mise en garde apportée par la littérature internationale de Granqvist & als. et Forslund & als. (2017, 2021), le risque est de glisser d’une lecture clinique à une lecture probatoire, transformant un concept scientifique de recherche en outil clinique et “preuve” de danger.
La fonction de ce discours est de protéger l’enfant, mais son application est parfois déformée. L’attachement est alors utilisé comme preuve d’incapacité parentale, voire judiciarisé, garant de “bonne parentalité”, et au pire du pire, pourrait conduire à une forme de permis de parentalité. On l’emploie parfois pour justifier des décisions sans qu’à minima des méthodes extrêmement rigoureuses d’évaluation aient été utilisées.
En conclusion, non seulement, selon l’utilisation de la théorie de l’attachement que l’on fait, les auteurs dont on se revendique font qu’en fait on ne parle pas tous des mêmes choses, souvent sans le savoir, mais, de surcroît, d’autres questions émergent auxquelles l’article de Duschinsky et collaborateurs ne répond pas : est-ce que ces différents discours sont tous égaux quant à leurs applications cliniques ? Et peuvent-ils dialoguer, permettre un consensus entre les professionnels ?
Je ne suis pas certaine d’avoir une réponse à ces questions, mais je vous propose de déployer ma réflexion, mes idées sur ce sujet.
III. Le DMM, la posture intégrative et l’axe de la profondeur clinique dans l’utilisation des concepts de la théorie de l’attachement
1. Vers une lecture verticale : les niveaux de profondeur clinique
L’analyse de Duschinsky met de l’ordre dans le chaos des discours sur la théorie de l’attachement.
Elle montre comment cette théorie s’est fragmentée en plusieurs registres qui coexistent, se croisent parfois, sans que les cliniciens en aient toujours conscience.
En réalité, on pourrait considérer qu’ il n’existe pas une mais six “théories de l’attachement”, selon les contextes où elles sont mobilisées.Mais cette lecture reste horizontale : elle juxtapose des discours, sans hiérarchiser leur profondeur clinique.Or, en pratique, ce n’est pas la même chose de parler d’attachement depuis un manuel de psychoéducation, un laboratoire de recherche, une salle de supervision ou un service de pédopsychiatrie. Ce ne sont ni les mêmes populations, ni les mêmes besoins, ni les mêmes enjeux de prise en charge, de changement. On peut donc proposer une lecture verticale de ces six discours et je propose de les classer selon leur niveau de profondeur clinique, c’est-à-dire selon le niveau de souffrance des sujets concernés, leur résistance au changement, et la complexité du savoir et des méthodes nécessaires pour promouvoir une évolution vers plus de sécurité. Ainsi, on pourrait dire que le discours populaire n’a pas de profondeur clinique : il est médiatique, grand public, destiné à informer. Il n’a pas assez de puissance conceptuelle, méthodologique, pour générer des changements profonds, si ce n’est promouvoir une curiosité sur les besoins de l’enfant. À l’inverse, les discours de la protection de l’enfance et de la psychiatrie opèrent à une profondeur clinique maximale, car ils s’adressent à des individus qui ont beaucoup souffert et souffrent beaucoup dont le système défensif est hautement organisé autour du danger, de la survie ou du trauma. Ces discours, dans leurs applications cliniques, requièrent un savoir dense, des méthodologies rigoureuses, une tolérance à la complexité et un refus des simplification, stigmatisation.
On le voit, rajouter une organisation verticale de ces six discours de la théorie de l’attachement selon la clinique à laquelle ils s’adressent change tout : il ne s’agit plus de déterminer quel discours est le bon, mais de comprendre quel type de discours on recrute, à quel moment, et pour quel terrain clinique, quelle problématique.
À mon sens, une formation, une supervision ou une intervention relationnelle se situent toujours à un niveau implicite de profondeur clinique. Et sans conscience de ce niveau, on risque d’utiliser un registre discursif inadapté à la situation — un langage trop superficiel pour des problématiques profondes, ou inversement.
Par exemple, quand je forme des professionnels de crèche, je suis à un premier niveau de profondeur clinique. Il s’agit de rendre les professionnels plus sensibles à la communication relationnelle du bébé et de favoriser un changement de représentation : d’un bébé difficile, capricieux, qui cherche l’attention, à un petit qui communique des besoins émotionnels et relationnels de la meilleure façon qu’il peut en fonction de son tempérament, de son histoire, de son âge développemental.
Je n’ai, dans ces cas-là, aucun besoin de leur parler des différents patterns d’attachement et encore moins de la notion de désorganisation de l’attachement, pour plusieurs raisons. La première : ces professionnels de terrains de la petite enfance n’ont généralement pas accès à des formations suffisamment longues pour assimiler ces concepts complexes et les utiliser sans difficulté, donc au mieux la formation ne leur sert à rien, au pire on les met en difficulté. Deuxièmement, la sémantique des patterns d’attachement, non suffisamment assimilée, est recrutée pour « diagnostiquer l’enfant » ce qui peut être stigmatisant et à nouveau performatif. Si vous pensez un petit comme désorganisé en terme d’attachement vous agissez avec lui en fonction de ce concept même si vous n’en avais pas de véritable preuve empirique.
Il en est de même quand je travaille avec les parents. La psycho-éducation attachement-informée ne requiert pas que l’on présente les différents patterns d’attachement aux parents ou même que leur donne leur « classification » d’attachement. Etre identifié « évitant » ( sans AAI généralement) ne vous aide pas à vous comprendre mieux ou à vous découvrir et découvrir d’autre façon d’être, ça vous aide juste à blâmer le passé et justifier vos comportements si ce n’est pas accompagner dans une vraie démarche thérapeutique d’intégration et de changement. D’ailleurs, dans aucun des programmes attachement-informés (Cercle de Sécurité, Intervention Relationnelle, Theraplay, VIG) dans lesquels je me suis formée on a recours à cela, les patterns d’attachement ne sont ni utilisé, ni nommés aux parents.
Pour le dire de manière volontairement caricaturale : un influenceur sur TikTok qui parle de “trouble de l’attachement” n’utilise probablement pas le bon discours même s’il est expert sur le sujet.
2. Le discours de Crittenden et du DMM : un septième discours intégratif
En intégrant cette dimension de la profondeur clinique du discours d’attachement utilisé, je propose maintenant de situer celui de Patricia McKinsey Crittenden avec le DMM.
La particularité, selon moi, c’est qu’il est intégratif, car il agrège plusieurs des discours précédemment présentés en un seul.
Car le DMM (Dynamic Maturational Model of Attachment and Adaptation) reprend la rigueur empirique du discours développemental, intègre la complexité du danger issue du discours d’attachement pour la protection de l’enfance, conceptualise les liens avec la psychopathologie comme le discours d’attachement psychiatrique et psychothérapeutique, et conserve une exigence scientifique centrale. Il articule les différentes discours/conceptions de la théorie de l’attachement, les organise en un tout théorique cohérent et permet ainsi de naviguer entre les différents niveaux de profondeurs cliniques.
En ce sens, le discours DMM de l’attachement permet / promeut un consensus et répond à la question que je posais plus haut : est-ce que ces différents discours sur l’attachement peuvent dialoguer ensemble ?
Pour résumer, le DMM :
— Garde la rigueur empirique du développemental en ayant un recours massif aux méthodologies d’évaluation et à la rigueur scientifique (AAI, PAA, CARE-Index) ;
— Introduit une compréhension fine du danger, du trauma et des stratégies de survie et a développé un modèle des possibilités de stratégies d’attachement, basé sur le traitement de l’information qui les sous-tend, ce qui permet de penser le risque de psychopathologie, l’inadaptation du sujet, le trauma développemental et donc de le prendre en charge.
— Offre un cadre de formulation de la souffrance, de la désadaptation pour la psychothérapie et la psychiatrie, sans tomber dans la moralisation, la psychologisation du lien ou le diagnostic-étiquette. Il empêche la catégorisation simplificatrice, et les discours populaires souvent délétères, en générant une pensée complexe.
— C’est une approche centrée sur les ressources et non sur les dysfonctionnements.
Contrairement au discours psychosocial, le DMM ne s’appuie sur aucune auto-évaluation ni auto-perception : il repose sur l’analyse du discours, du comportement et du traitement de l’information. Le discours psycho-social d’attachement n’est donc pas intégré dans le DMM, de même que le discours populaire qui simplifie outrageusement la théorie.
Le DMM est un discours sur l’attachement qui est clinique, maturationnel et profondément éthique, qui redonne à la théorie de l’attachement sa profondeur conceptuelle : une théorie clinique, orientée vers l’espoir de changement pour le sujet en souffrance. Son plus gros défaut c’est sa densité, sa complexité. Il requière une démarche de formation longue et rigoureuse.
IV. Un petit outil réflexif : “D’où parlez-vous de l’attachement ?”
Je vous propose, à la fin de cet article, un petit outil réflexif pour savoir quel est le discours sur l’attachement que vous utilisez.
L’idée est de vous aider à prendre conscience de l’endroit théorique à partir duquel vous parlez, vous pensez, enseignez, ou soignez sur l’attachement. Car vous l’aurez compris, nous n’avons pas tous la même porte d’entrée dans la théorie de l’attachement : certains l’abordent par la recherche, d’autres par la parentalité, la psychothérapie, la protection de l’enfance ou la clinique du trauma. Moi, je l’aborde par la protection de l’enfance, et la thérapie des populations vulnérables.
Chaque point de vue est légitime, mais chacun voit une partie différente de l’éléphant qui est dans la pièce et porte aussi des risques dont il faut être conscient. Ce petit guide vous invite à répondre à une série de questions simples mais intéressantes à explorer, je crois :
— Comment définissez-vous l’attachement ? Un type de relation, un mécanisme de défense, une organisation psychique, relationnelle…
— Qu’est-ce que vous cherchez à observer ? Le comportement, les représentations inconscientes, les représentations conscientes ?
— Quels sont vos auteurs de référence ?
— Quels sont vos outils de référence ?
— Quel vocabulaire utilisez-vous ? Style d’attachement ? Pattern d’attachement ? Stratégie d’attachement ? Attachement évitant / anxieux ? Attachement sécure, anxieux-évitant / anxieux-ambivalent / désorganisé ? Trouble de l’attachement ?
— Qu’est-ce qu’un enfant “sécure” pour vous ?
— À quelle profondeur clinique pensez-vous la question de l’attachement ? Grand public, population tout-venant, professionnels de la petite enfance, population traumatisée, psychiatrique, criminelle.
— Qu’attendez-vous de la théorie de l’attachement : qu’elle explique, diagnostique, transforme, nomme ?
Il n’y a pas de “bonnes” ou “mauvaises” réponses.
Vos réponses permettent simplement d’identifier votre discours dominant sur l’attachement, votre filiations théorique avec certains auteurs, les angles morts (les niveaux qu’on évite ou qu’on dénigre), et la compatibilité de votre pratique avec les autres discours et le DMM (puisque vous êtes sur mon blog :)). Elle vous permets aussi peut être de prendre conscience que le champ est vaste et que vous ne connaissez peut être pas tout de la théorie de l’attachement 🙂 .
Pour interpréter vos réponses aux questions ci-dessus, consultez le tableau ci-dessous qui synthétise les six discours et leur niveau de profondeur clinique.
| Type de discours | Contexte d’émergence | Auteurs / figures-clés | Objectif principal | Méthodes ou outils utilisés | Caractéristiques clés | Limites ou risques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Populaire / médiatique | Années 1950 à aujourd’hui – diffusion grand public, réseaux sociaux, parentalité “positive” | Bowlby (1951) ; auteurs de vulgarisation contemporains (Johan lemieux, Cyrulnick pour le meilleurs, etc.) | Rendre la théorie accessible et rassurante pour se comprendre soi, ses enfants | Aucun outil systématique ; métaphores, exemples, récits personnels | L’attachement comme amour, lien, sécurité émotionnelle ; approche intuitive et parfois moralisatrice, déterministe | Simplification, confusion entre amour et sécurité, pseudo-expertise, discours prescriptif ou culpabilisant= le parent pas assez sécurisant |
| 2. Développemental / scientifique | Recherche universitaire depuis Ainsworth (1970s) ; laboratoires d’observation | Ainsworth, Main, Sroufe, Waters, van IJzendoorn… | Décrire et prédire les patterns d’attachement et leurs effets développementaux | Situation Etrange, Entretien d’attachement de l’adulte, études longitudinales, méta-analyses | Rigueur méthodologique, cohérence empirique, transmission par formation | Cloisonnement, manque d’application clinique, rigidité des catégories, peut de transposition pour la clinique, une certaine forme d’entre soi |
| 3. Social-psychologique / expérimental | Psychologie sociale et de la personnalité (années 1980) | Hazan & Shaver, Brennan, Mikulincer, Fraley | Étudier les styles relationnels adultes et les différences individuelles | Questionnaires auto-rapportés (ECR, SAAM) ; analyses factorielles | Deux dimensions principales : anxiété / évitement ; attachement comme style relationnel, presque trait de personnalité | Travail sur les représentation consciente uniquement , perte de la richesse développementale de la théorie, simplification dangereuse surtout dans les applications pour le couple, génère des auto diagnostic |
| 4. Psychothérapeutique / clinique | Psychothérapie relationnelle et intégrative (années 1990-2000) | Holmes, Schore, Fonagy, Johnson, Steele, Crittenden dans une certaine mesure | Utiliser la théorie pour comprendre et réparer les blessures relationnelles, rendre plus sécure | Formulation clinique, AAI, MBT, DDP, EFT, TAAM, THERAPLAY, ICV, COS, VIPP, AVI… | Prise en charge du trauma developpementale, Attachement comme base de sécurité thérapeutique, régulation affective, mentalisation, alliance thérapeutique | Emploi thématique et modélisant des concepts, borderline diagnostic, attachement et ses concepts comme mots valide auto définit et parfois performatifs |
| 5. Psychiatrique / diagnostique | DSM-III (1980) puis psychiatre infantile contemporaine | APA (1980), Allen & Schuengel, Zimmermann, Coughlan | Définir les troubles de l’attachement (RAD / DSED) | Observation clinique, critères DSM / CIM | Attachement conçu comme trouble réactionnel à des soins défaillants | L’attachement est dysfonctionnel, la dysfonctionnel est portée par l’enfant, pathologisation des troubles du liens, consensus scientifique discutable |
| 6. Protection de l’enfance / travail social | Politiques publiques, justice familiale, services sociaux | Forslund, Pearce, North, Van IJzendoorn, Steele, Crittenden, lyons Ruth, shaming … | L’attachement comme évaluation de laqualité du lien et la compétence parentale | Observations informelles, outils dérivés, rapports sociaux, recours massif à la notion de désorganisation comme marqueur de risque | Attachement comme indicateur du “bon parent” ; concept d’abus émotionnel, trauma developpementale | Usage moral ou judiciaire, manque de rigueur scientifique, dérives interprétatives et prédictives, utilisation de la théorie pour prédire le risque et « simplifier » les décisions protection de l’enfance. |
V. Conclusion
À travers ce parcours, ce que j’ai voulu montrer, c’est que la théorie de l’attachement n’est pas unique. C’est un modèle de pensée et un langage qui regroupe en fait différents discours applicables à différents contextes, à des niveaux d’actions cliniques différents.
La richesse du travail de Duschinsky est d’avoir donné une carte de ces différents angles de la théorie de l’attachement. J’ai essayé de rajouter une dimensions vertical de profondeur clinique qui introduit de la nuance au regard des « usagers » de la théorie de l’attachement à qui ont s’adresse en convoquant cette dernière.
La responsabilité de notre génération de cliniciens, formateurs, chercheurs et auteurs est sans doute, me semble-t-il, d’être rigoureux quant à l’utilisation que nous faisons de la théorie de l’attachement, de savoir reconnaître et communiquer quel est le discours scientifique de la théorie de l’attachement auquel nous nous identifions et que nous utilisons, en gardant à l’esprit que d’autres professionnels peuvent communiquer à partir d’autres conceptions.
Il s’agit aussi de s’assurer que l’on utilise le bon discours, le bon positionnement théorique en fonction de notre intention, de notre clinique, du besoins des personnes à qui ont s’adresse au risque de mal utiliser la théorie et de générer de la confusions, voire des effets négatifs.
Texte publié le 30 octobre 2025 dans le cadre du Blog A-T-L-A-S : un blog clinique pour explorer les liens qui façonnent l’humain.*
— Alexandra Deprez
Merci pour votre lecture
Merci d’avoir pris le temps de lire cet article.
Si vous avez une question, une réflexion ou une nuance à partager, n’hésitez pas à laisser un commentaire ou m’écrire : vos retours nourrissent mon travail.
Se former à la théorie de l’attachement
Vous êtes professionnel·le de la santé, du social ou de l’éducation ?
J’ai conçu une formation complète à la théorie de l’attachement, 100 % en ligne et interactive.La nouvelle version arrive en janvier 2026.
Soutenir mon travail
Ce blog est indépendant, sans publicité, et il me demande beaucoup d’énergie pour vous offrir des contenus rigoureux, sensibles et utiles.
Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez m’offrir un café virtuel via Buy Me a Coffee :
Soutenir le blog : [Lire pourquoi et comment ici]
Recevoir la newsletter
Je partage régulièrement des contenus inédits sur l’attachement, la parentalité, les dérives du développement personnel, ou encore le lien entre IA et humanité.
Pour recevoir ces articles directement dans votre boîte mail, inscrivez vous ci dessous.
Copyright © 2025 Alexandra Déprez-
Tous droits réservés. Aucune partie de ce site web, à l’exception des brèves critiques et des liens vivants vers ce site web, ne peut être copiée ou utilisée sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit. Toute utilisation doit faire apparaître de façon claire et évidente l’attribution à Alexandra Deprez à l’adresse alexandradeprez.fr. L’utilisation de ce contenu par des systèmes automatisés d’intelligence artificielle à des fins d’entraînement, d’imitation ou de génération est strictement interdite sans autorisation écrite préalable
Référecences de cet article
Duschinsky, R., Bakkum, L., Mannes, J. M., Skinner, G. C., Turner, M., Mann, A., … & Beckwith, H. (2021). Six attachment discourses: Convergence, divergence and relay. Attachment & human development, 23(4), 355-374.
Granqvist, P., Sroufe, L. A., Dozier, M., Hesse, E., Steele, M., van Ijzendoorn, M., … & Duschinsky, R. (2017). Disorganized attachment in infancy: A review of the phenomenon and its implications for clinicians and policy-makers. Attachment & human development, 19(6), 534-558.
Forslund, T., Granqvist, P., Van IJzendoorn, M. H., Sagi-Schwartz, A., Glaser, D., Steele, M., … & Duschinsky, R. (2022). Attachment goes to court: Child protection and custody issues. Attachment & Human Development, 24(1), 1-52.

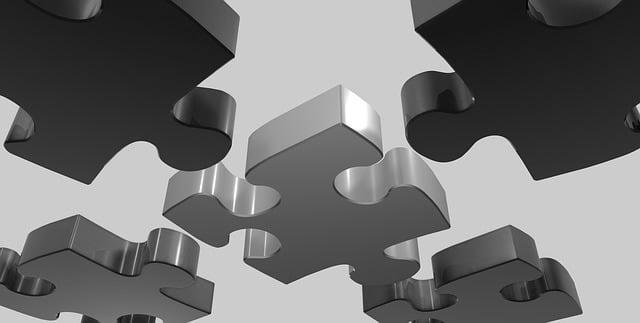
Commentaires récents