Tout le monde parle de l’attachement. Mais parle-t-on vraiment de la même chose ? Derrière les mots « style », « profil », « pattern », « stratégie » se cachent des concepts distincts, issus de courants théoriques, de méthodologies et de niveaux d’analyse très différents. Et, pourtant, ils sont souvent utilisés comme s’ils étaient interchangeables. Ce flou sémantique n’est pas qu’un détail de puriste : il brouille la compréhension, fragilise les communications cliniques et peut mener à des erreurs d’interprétation graves. Cet article propose une mise au point claire, nuancée, pour penser plus justement l’attachement – et mieux en parler.
Table des matières
Introduction :
Dans le champ de l’attachement, je constate que les mots circulent plus vite que la compréhension des concepts qu’ils sous-tendent. Ainsi, de diffusion approximative en répétition trop rapidement relayée, le flou conceptuel augmente, s’installe, sans que les professionnels eux-mêmes s’en aperçoivent. Ils ne réalisent pas qu’ils ne parlent en fait pas tout à fait de la même réalité scientifique, qu’ils ne convoquent pas les mêmes auteurs, les mêmes courants théoriques, les mêmes méthodologies et résultats de recherche.
Ainsi, dans l’utilisation courante, sociale, médiatisée de la théorie de l’attachement, on utilise indifféremment les termes style, profil, pattern (patron en français), stratégie d’attachement. Les professionnels n’ont pas toujours conscience que chacun de ces termes a une signification précise, une histoire scientifique, une méthode, des auteurs.
Cet article se propose de comprendre pourquoi c’est un problème et de clarifier le vocabulaire.
Pourquoi est-ce un problème d’utiliser les termes style, profil, stratégie, pattern d’attachement de façon interchangeable ?
Le flou sémantique n’est pas un détail, il entrave la réflexion parce que le fondement de celle-ci, les mots et leurs définitions sont incertains. Or, ce qui se pense mal, se communique mal. Ce flou sémantique pollue donc les échanges entre disciplines pour les chercheurs et entre professionnels pour les cliniciens et, par le processus de la vulgarisation scientifique, conduit à une information de mauvaise qualité transmise auprès de la population. Enfin, selon moi, le pire des effets de ce flou sémantique, c’est que cela expose à des erreurs d’interprétation et de mise en sens graves. Lorsque l’attachement, son utilisation clinique, deviennent un argument dans des rapports écrits concernant l’enfant, son avenir, sa famille, quand elle est convoquée comme argument d’expertise dans la parentalité ou dans la thérapie, le flou devient dangereux.
Mise au point sémantique
Je vous propose ici de faire le point. Pour chaque terme évoqué, je propose une définition, de la lier avec l’école théorique à laquelle elle appartient, ainsi qu’aux auteurs qui en sont les initiateurs, et enfin de clarifier la méthodologie qui leur est liée. Enfin, je propose de commenter dans quel contexte clinique elles peuvent utilement être utilisées.
1. Pattern (schéma / patrons d’attachement)
Définition : catégorisation de l’attachement selon des configurations (sécurisé, évitant, résistant, désorganisé), fondée sur les comportements manifestes, et donc observables en situation de séparation/réunion, notamment dans la situation étrange chez l’enfant de 11 mois à 6 ans. La validité la plus forte étant pour les jeunes enfants de 11 à 18 mois. Les évaluations des enfants plus grands étant plus complexes et moins valides (ex. Strange Situation).
Auteurs et école : cette terminologie est issue des travaux de Mary Ainsworth. Elle a été reprise par Mary Main et plus généralement tous les auteurs qui s’inscrivent dans cette filiation qui appartiennent à la tradition développementale Bowlby-Ainsworth de la théorie de l’attachement. C’est le terme principalement utilisé par les tenants du modèle ABC+D (sécurisé B, évitant A, ambivalent/résistant C, désorganisé D).
Spécificité : ce terme sert à classer globalement le comportement d’attachement chez le jeune enfant, selon des réactions identifiables lors de stress relationnels. Ce sont des construits de recherche, ils ne possèdent pas de fonction de diagnostic et n’ont pas été conçus à ces fins, contrairement à ce que l’usage courant de la théorie de l’attachement semble valider. Leur utilité est essentiellement une utilité de recherche, à condition d’être formée et validé comme fiables aux outils qui permettent de faire les classifications. Ces patterns d’attachement sont utiles aussi dans le cadre de la formation. Ils permettent aux professionnels de créer des représentations concrètes des expressions individuelles spécifiques de l’attachement des tout petits en lien avec leur figure d’attachement. Mais ces sensibilisations en quelques vidéos ne suffisent pas pour prétendre savoir évaluer l’attachement à des fins cliniques. (Je proposerai bientôt un article sur ce sujet)
2. Profile d’attachement
Définition : il s’agit d’un portrait plus détaillé des caractéristiques d’attachement fondées sur la représentation (interne ou narrative), souvent issues d’entretiens semi-directifs codés ensuite avec un Q‑sort ou une méthode de cotation (il en existe plusieurs).
Auteurs et écoles : ce terme est utilisé principalement dans le champ de l’étude de l’attachement chez l’adulte qui utilise les méthodes d’analyse de discours pour déterminer quelles sont les représentations d’attachement inconscientes chez l’adulte. (Adult Attachement Interview, Main, George, Kaplan) .
Spécificité : l’accent est ici mis sur la structure narrative interne (internal working models- modèles interne opérant), la cohérence discursive. Les catégories sont : secure, dismissing, preoccupied, fearful, en lien avec celles du jeune enfant. Ce terme s’applique surtout à l’évaluation chez l’adulte ou l’adolescent. Cela ne s’applique donc pas à la description /catégorisation des comportements. En effet, chez les grands enfants, les adolescents et les adultes, le comportement n’est plus révélateur de la stratégie, comme dans la petite enfance, par apports du développement.
3. Stratégie d’attachement
Définition : C’est un ensemble adaptatif de réponses cognitives/affectives façonné par la nécessité de restaurer la sécurité dans des environnements incertains ou dangereux. Il existe trois catégories qui reflètent conceptuellement celles des bébés à la situation étrange, mais avec des transformations apportées par le développement : stratégies de Type A ( biais cognitif), stratégies de type C (Bias affectif) ou de type B (équilibrée/balanced), il est possible d’avoir une stratégie A/C, mais la désorganisation de l’attachement n’est pas reconnue comme un concept valide.
Auteurs et école : cette typologie repose sur le travail de Patricia Crittenden (Dynamic-Maturational Model), ancienne doctorante de Mary Ainsworth (lien vers l’article). La filiation méthodologique repart de Bowlby et de ses idées sur l’attachement comme un système de maintien de la proximité/disponibilité de la figure d’attachement, mais également du traitement de l’information relationnelle et adaptative sous stress.
Spécificité : ici, l’attachement est modélisé comme stratégie protectrice qui implique un traitement de l’information sous stress spécifique et construit par l’expérience de développement en lien avec les figures d’attachement. Chaque stratégie implique ou non des biais de traitement de l’information et la présence ou non de transformations de l’information : A : priorise la cognition, minimise l’émotion ; C : l’inverse ; B : utilise simultanément l’information cognitive et émotionnelle sous stress pour s’adapter. Les termes sont valides à tous les âges de la vie puisqu’ils reposent sur les modalités internes et neurologiques d’organisation, lesquelles s’expriment, et donc s’observent dans le discours ou les comportements selon les âges. Cela autorise une continuité méthodologique et développementale des outils, ce qui n’est pas le cas dans les modèles ABC+D.
4. Style d’attachement
Définition : c’est un terme plus général, souvent utilisé en psychologie sociale et dans le champ des applications de la théorie de l’attachement à la relation adulte, au couple, désignant une disposition stable (sécurisant, anxieux, évitant, désorganisé).
Auteurs et école : ce terme découle plutôt du travail d’auteurs comme Bartholomew & Horowitz (modèle à deux dimensions créant quatre catégories).
Spécificité : le terme concerne donc l’orientation affective dans les relations interpersonnelles, mesurée par questionnaires autorapportés, utilisés surtout à l’âge adulte. Ce qui est important de retenir, c’est qu’il n’est pas réellement démontré que ce type de méthodes évaluent les mêmes caractéristiques de l’attachement que l’AAI. En effet, elle se distingue par le fait qu’ici, on évalue les représentations conscientes ou au moins conscientisables par la personne qui va faire le questionnaire. C’est cette spécificité qui met cette conception de l’attachement à part. On pourrait même pousser un peu plus loin et se demander : est-ce bien encore l’attachement qu’on évalue ? Celui qui s’inscrit dans la filiation d’Ainsworth, ou est-ce une autre dimension de la relation et des représentations qui en découlent liée à l’attachement, mais pas l’attachement lui-même ? Ou alors seulement une partie de l’attachement, celle qui est accessible consciemment ? Je ne suis pas à jour sur ce débat, je regarderais, mais je crois qu’il n’est pas résolu. Dans tous les cas, cette branche de la théorie de l’attachement, sa sémiologie, est celle qui est la plus vulgarisée, notamment sur les réseaux sociaux et grâce à des livres « best-seller » parce qu’évidemment des évaluations “fiables”, rapides, non coûteuses et permettant un “diagnostic” rapide de son attachement sont très attrayantes. Cependant, c’est, selon moi, la forme d’évaluation la moins utile en psychopathologie et pour la prise en charge clinique. Elle a aussi le potentiel, je crois, de faire plus de dégâts, en générant un discours stéréotypé de l’attachement et la mise à disposition d’auto-questionnaires en ligne qui ont le gros désavantage d’être performatifs.
Une comparaison synthétique
| Terme | Niveau | Approche | Auteurs clés | Usage |
| Pattern | Comportement observable | Observations Strange Situation- classification en catégories | Ainsworth, Main, | Classification infantile standardisée-psychologie du développement |
| Profile | Représentation interne/narrative- pre-conscient/inconscient | Entretiens, classification Q-sort ou codage- classification en catégories. | Main, George,Kaplan et leurs étudiants | Étude de modèles internes chez ados/adultes |
| Strategie | Processus adaptatif – traitement de l’information sous stress (inconscient) | Codage DMM info-processing- classification en dimensions et codes. | Crittenden | Analyse du fonctionnement adaptatif et relationnel sous stress à tous les âges de la vie |
| Style | Disposition relationnelle (conscient) | Approche sociale / questionnaire- classification en dimension pour les versions les plus récentes | Bartholomew, Fraley & Shaver ECR-S Brennan clark shaver | Applications relationnelles adultes- |
Note sur les termes “profil” et “style” d’attachement
La distinction que je propose ici entre profil (issu d’évaluations narratives codées comme l’AAI) et style (issu de questionnaires autorapportés) est conceptuellement utile pour clarifier les usages… mais elle n’est pas absolue. Dans la littérature, les deux termes sont parfois employés de façon interchangeable, même par des chercheurs reconnus. Certaines études parlent de « attachment profile » pour désigner des styles autorapportés, d’autres parlent de « style » pour désigner des configurations issues d’entretien. Cela reflète l’histoire mouvante du champ, la diversité des écoles de pensée, et occasionnellement aussi… un certain relâchement terminologique. J’ai donc choisi ici de proposer une grille de lecture claire, mais non dogmatique, afin de faciliter la compréhension tout en gardant à l’esprit que la rigueur passe aussi par la reconnaissance des ambiguïtés.
Les questions à se poser pour savoir de quoi on parle :
- Pattern : « Que fais-tu et que l’on peut voir quand tu es bébé ou un jeune enfant ? » Pas observable avant 11-12 mois
- Profile : « Comment racontes‑tu tes histoires d’attachement ? » (cohérence, thèmes)
- Stratégie : « Quel traitement de l’information sous stress fais-tu quand tu parles de tes relations significatives et des dangers auxquels tu as été confronté ? »
- Style : « Quelle est ton orientation relationnelle consciente envers les personnes significatives dans ton environnement ? »
Pourquoi il est utile de savoir distinguer les différents termes ?
- Pour la clarté scientifique : en effet, chaque terme est un « objet » scientifique explicitement circonscrit – du comportement brut à l’organisation cognitive interne. Il appartient à un champ conceptuel et à une branche de recherche. Cela permet d’interpréter correctement les résultats des études scientifiques et de les relier à l’histoire de la théorie de l’attachement.
- Pour savoir quand les utiliser et comment : les patterns, c’est pour les petits enfants, les profils et les stratégies pour la clinique des ados/adultes, le style pour les études relationnelles générales. Il s’agit d’être dans une pertinence développementale pour chaque concept.
- Enfin, cela permet de savoir quelles sont les correspondances méthodologiques : observations vs entretiens vs auto‑questionnaires vs codage info-processing détaillé. Utiliser les bons termes autorise donc de choisir les outils que l’on veut utiliser. Cela assure de connaître spécifiquement ce qu’on évalue, la validité scientifique. Par exemple, est-ce une dimension consciente ou inconsciente ? Et in fine de pouvoir interpréter les résultats qui découlent de ses évaluations/observations.
Conclusion
Alors… la théorie de l’attachement sait-elle de quoi elle parle ? Sans doute.
Mais, ses héritiers, ses vulgarisateurs, ses cliniciens pressés ? Un peu moins.
Il est peut-être temps de reparler d’attachement — avec attachement aux mots. 😊
Sur le plan scientifique, distinguer ces termes est, selon moi, essentiel : ils permettent de rendre compte de la complexité de l’attachement à chaque étape du développement humain.
Utilisés sans précision ni distinction, de façon interchangeable dans les formations ou les communications cliniques, ils exposent à une vision trop simpliste, caricaturale, stéréotypée — ou pire inappropriée de la théorie de l’attachement.
Ce flou sémantique ne rend pas justice à la richesse de la théorie ; il révèle aussi, parfois, la faiblesse des formations initiales sur le sujet.
Une fois ces clarifications posées, une question reste ouverte :
À quel concept est-ce que je me réfère, moi, quand j’écris ou parle d’attachement ?
En somme, les quatre notions sont complémentaires, mais la stratégie d’attachement, telle qu’elle a été modélisée par Patricia Crittenden dans le DMM, est la conception que j’adopte, utilise et sur laquelle je communique.
Elle propose, à mes yeux, le cadre le plus nuancé et opérationnel pour saisir la manière dont les individus s’adaptent réellement à leur environnement — dans la durée, et en fonction des contextes, de leurs expériences relationnelles.
C’est une notion riche, pertinente pour penser des interventions aussi bien en clinique qu’en recherche.
Elle a aussi le grand avantage de permettre une continuité développementale à tous les âges de la vie. On ne passe pas de patterns d’attachement dans la petite enfance à des profils à l’âge adulte comme dans le modèle ABC+D qui oblige à expliciter ce processus de transformation — ce que la théorie dominante peine encore à formaliser clairement.
Par défaut, je parle donc des stratégies d’attachement, et je m’appuie sur le modèle DMM pour réfléchir et communiquer — sauf si je stipule explicitement que ce n’est pas le cas.
Ce blog est tout jeune. Dans le monde du blogging, c’est un nouveau-né de quelques jours.
Il me semblait donc important de clarifier, dès le début de cette aventure d’écriture, ce point sémantique et la position que j’y adopte.
Questions finales
Est-ce que cet article présentait un intérêt pour vous ?
Ou n’ai-je abordé que des évidences ?
Merci de me dire en commentaire, cela m’aide à savoir quoi écrire à l’avenir.
Texte publié le 21 juin 2025 dans le cadre du projet A-T-L-A-S : un blog clinique pour explorer les liens qui façonnent l’humain.*
— Alexandra Déprez
Merci pour votre lecture
Merci d’avoir pris le temps de lire cet article.
Si vous avez une question, une réflexion ou une nuance à partager, n’hésitez pas à laisser un commentaire ou m’écrire : vos retours nourrissent mon travail.
Soutenir mon travail
Ce blog est indépendant, sans publicité, et il me demande beaucoup d’énergie pour vous offrir des contenus rigoureux, sensibles et utiles.
👉 Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez m’offrir un café virtuel via Buy Me a Coffee :
Soutenir le blog : [Lire pourquoi et comment ici]
Recevoir la newsletter
Je partage régulièrement des contenus inédits sur l’attachement, la parentalité, les dérives du développement personnel, ou encore le lien entre IA et humanité.
👉 Pour recevoir ces articles directement dans votre boîte mail, inscrivez vous ci dessous.
Se former à la théorie de l’attachement
Vous êtes professionnel·le de la santé, du social ou de l’éducation ?
J’ai conçu une formation complète à la théorie de l’attachement, 100 % en ligne et interactive.
Découvrir la formation
Copyright © 2025 Alexandra Déprez-
Tous droits réservés. Aucune partie de ce site web, à l’exception des brèves critiques et des liens vivants vers ce site web, ne peut être copiée ou utilisée sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit. Toute utilisation doit faire apparaître de façon claire et évidente l’attribution à Alexandra Deprez à l’adresse alexandradeprez.fr

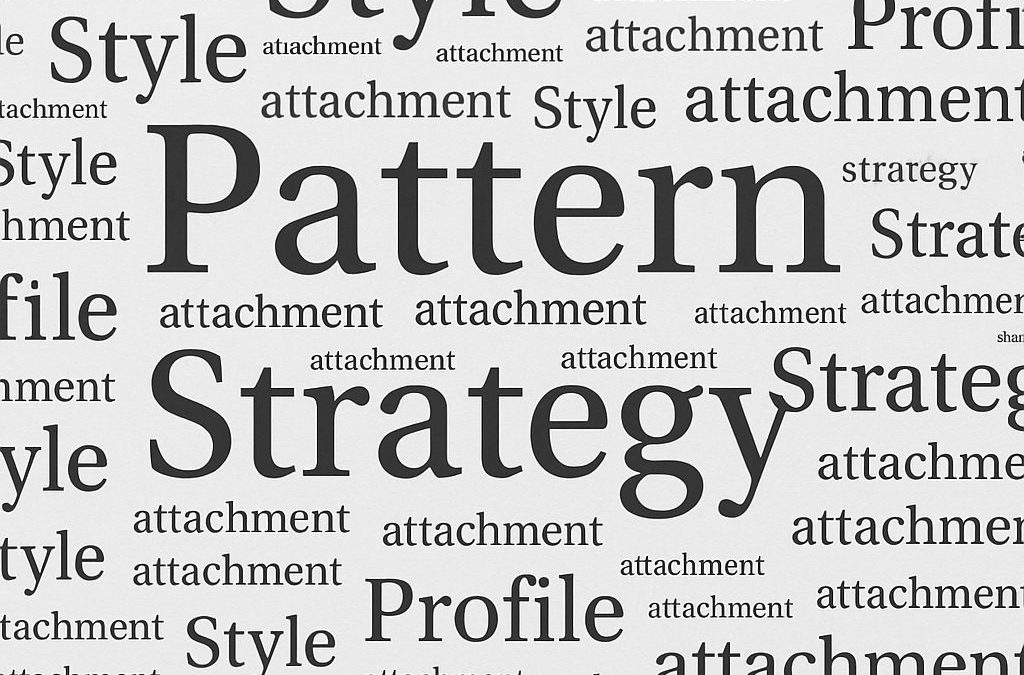
Commentaires récents