5 étapes primordiales pour monter en compétences, basées sur mon propre cheminement, mes erreurs, pour devenir expert des interventions cliniques attachement informées.
Table des matières
Introduction
La théorie de l’attachement suscite un intérêt croissant. Les offres de formation se multiplient — avec des niveaux de qualité très variables.
Alors, comment s’y retrouver ?
Comment, lorsqu’on souhaite intégrer la théorie de l’attachement dans sa pratique clinique, concevoir un parcours de montée en compétence qui permette d’acquérir des savoirs et des savoir-faire solides, sans se perdre dans une accumulation désordonnée ?
Cela fait plus de vingt ans que je travaille avec la théorie de l’attachement. Au fil du temps, j’ai suivi de nombreuses formations :
- des formations théoriques,
- des spécialisations cliniques,
- des approches centrées sur l’évaluation,
- d’autres sur l’intervention.
Dans cet article, je vous propose une réflexion nourrie par cette expérience. Non pas une méthode unique, ni un raccourci séduisant, mais un repère pour tracer votre propre chemin — avec exigence, clarté, et cohérence clinique.
avec exigence, clarté, et cohérence clinique.
1. Commencer par l’observation des interactions précoces
Je crois que je commencerais par une formation approfondie à l’observation des interactions précoces, et donc probablement par l’ADBB, le CARE-Index ou le CIB.
Moi, dans la réalité, j’ai commencé par des lectures, des ateliers « pseudo-attachement/parentalité », des formations de première intention soi-disant sur l’attachement qui, je le comprends aujourd’hui avec le recul, m’ont fait perdre mon temps et mon argent.
Puis, en 2009, j’ai fait le DU d’attachement. Riche, mais très théorique. J’en suis ressortie, je crois, la tête bien pleine mais sans compétences réelles.
Donc, si je devais refaire le parcours, je commencerais par me former à l’observation du bébé — et surtout à l’observation du tout-petit en relation.
Pourquoi ?
Parce que j’estime aujourd’hui qu’une connaissance intégrée de la théorie de l’attachement ne peut vraiment s’acquérir que lorsqu’on comprend en profondeur l’expérience de survie, l’expérience relationnelle du tout-petit, ce que cela implique pour sa construction psychique, et comment il nous le montre.
Ce n’est que par l’observation du bébé que l’on comprend ce qui est appris, intégré, mis en place comme comportements défensifs et protecteurs quand les parents ne sont pas disponibles, rejettent ou sont dangereux.
Ce n’est, il me semble, que par cette connaissance de l’observation comme méthode — même imparfaite — que j’ai pu assimiler, quant à moi, la dimension concrète de l’attachement dans l’organisation neurophysiologique et psychique du bébé.
Observer des dizaines, voire des centaines d’interactions au fil des formations m’a permis de construire une représentation interne des stratégies adaptatives du bébé pour maintenir ses liens. C’est cela qui m’a permis de comprendre les styles d’attachement comme stratégies, co-construites dynamiquement, et non comme étiquettes diagnostiques.
Sans ce savoir concret, il me semble que l’on reste dans une compréhension sémantique, plaquée, des notions comme la sensibilité parentale ou la synchronie, et de ce que sont réellement les stratégies d’attachement du point de vue du bébé. Ce savoir de surface complique alors toute réflexion sur comment intervenir pour que le sujet puisse acquérir plus de sécurité d’attachement.
2. Ensuite, je me formerais aux modèles théoriques
Une fois ce socle posé, je ferais une formation plus théorique pour comprendre l’ensemble des modèles de l’attachement.
Parce que oui, il existe plusieurs modèles théoriques, et il faut pouvoir les situer, les articuler et les questionner.
Le DU d’attachement, par exemple (que j’ai fait), ou la formation que j’ai moi-même développée « Intégrer la théorie de l’attachement dans les pratiques cliniques ».
Je ferais le choix d’une formation longue pour acquérir une connaissance approfondie, réflexive de la théorie de l’attachement.
En effet, les formations modulaires, en deux, trois, cinq jours de formation — même si c’est ce qui est principalement proposé sur le marché — ne peuvent pas atteindre ces objectifs.
Cela est, il me semble, d’autant plus nécessaire que l’on travaille avec des populations vulnérables, confrontées à l’adversité et au trauma.
Une formation de première intention s’avère alors totalement insuffisante.
Je choisirais une formation qui :
-
- présente les données développementales et neuroaffectives à jour, qui présente l’attachement à tous les âges de la vie dans une continuité,
- intègre les neurosciences affectives et la maturation cérébrale,
- tient compte de la culture,
- illustre par des exercices réflexifs, d’application, des cas, des vidéos, des transcripts — et pas juste un défilement de slides PowerPoint avec des références scientifiques
- et surtout, qui évite de réduire l’attachement à une théorie “recette de cuisine” où seule la sécurité de l’attachement a de la valeur.
Je m’assurerais que la personne formatrice :
- est formée à l’observation,
- connaît, a été formée, même si elle ne maîtrise pas forcément, les outils d’évaluation de l’attachement.
Hélas, nous sommes assez peu d’experts en France réellement formés de façon approfondie aux outils d’évaluation de la théorie de l’attachement et à l’observation.
Je mettrais ma main à couper que la quasi-totalité des formateurs à la théorie de l’attachement n’ont pas vu plus de quelques Situations Étranges ou lu d’Entretiens d’attachement de l’adulte.
Pourtant, ce sont ces outils qui ont permis le développement de la théorie de l’attachement.
Bien les connaître — même sans les maîtriser — signifie que l’on a vraiment intégré la théorie de l’attachement sous la forme d’un savoir concret, utilisable, pensable.
Moi, j’ai vu peut-être une centaine de Situations Étranges, et lu des dizaines d’Entretiens d’attachement de l’adulte.
-
- Et enfin, qu’elle n’utilise pas la théorie comme grille simplifiée ou étiquette figée.
Qu’elle connaisse, comprenne et maîtrise la distinction entre profil, pattern et stratégie d’attachement, par exemple.
Qu’elle puisse donner une définition opérationnelle de la sécurité de l’attachement, de la sensibilité parentale, et qu’elle soit capable d’articuler les autres théories du développement et de la psychologie avec la théorie de l’attachement, sans difficulté.
3. L’étape suivante serait de se former spécifiquement au psychotrauma
L’objectif serait de mieux comprendre les personnes qui ont grandi confrontées aux adversités chroniques.
Je ne le ferais pas avant, parce que sans une compréhension profonde du fonctionnement de l’attachement, je n’aurais pas eu les repères nécessaires pour saisir comment le trauma s’inscrit dans la relation, comment il se transmet entre les générations, comment il s’exprime à travers les stratégies d’attachement, et comment il peut empêcher la stratégie d’attachement de fonctionner.
En consultation, on ne reçoit en fait pas des personnes « sécures ». On reçoit ceux et celles pour qui l’insécurité de l’attachement est la norme, ils ne connaissent rien d’autre, ils n’ont pas de représentation de la sécurité. Ils se sont, en effet, développés dans des contextes souvent marqués par la maltraitance ou la négligence.
Au-delà du diagnostic de trauma développemental, il faut surtout, pour nous professionnels, intégrer, se représenter ce qu’est une expérience de vie qui implique une perception de soi, de l’autre, du monde, de la survie, du futur, de la compétence, du pouvoir — qui est étrangère et difficilement concrètement conceptualisable pour celles et ceux qui n’ont pas fait ces expériences de développement.
Nous avons donc besoin d’informations théoriques, cliniques et conceptuelles pour pouvoir nous représenter le mieux possible leur expérience du monde et des relations.
Il s’agirait de connaître, comprendre :
- la transmission transgénérationnelle du trauma,
- comment on survit, y compris psychiquement, y compris en souffrant quotidiennement, sans base de sécurité, sans havre de paix,
- comment on s’adapte et survit, même avec des symptômes psychopathologiques, quand les figures d’attachement font peur,
- et comment accueillir et faire sens de la souffrance sans réactiver leurs blessures.
4. Seulement alors, je me formerais aux outils cliniques, aux méthodes d’intervention
Il est séduisant de vouloir commencer par là, je sais parce que j’ai fait l’erreur : se former au Theraplay, à l‘EMDR, au Cercle de sécurité, à l’intervention relationnelle. Le problème, c’est que l’application de ces outils, leur utilisation, reste superficielle, difficile à implémenter sans avoir acquis les compétences des trois autres étapes que je propose.
Toutes ces techniques impliquent d’avoir une connaissance approfondie en observation, une connaissance de la théorie de l’attachement, du psychotrauma. Pourtant, si chacune fournit quelques informations théoriques (je sais, je les ai toutes faites), aucune ne forme de façon approfondie à l’observation hors de l’outil, aucune ne permet une connaissance approfondie de la théorie de l’attachement, surtout pour les populations en grande difficulté.
La raison en est logique : ce sont des formations à une technique, à un outil. Elles ne sont pas l’alpha et l’oméga de la connaissance clinique nécessaire pour prendre en charge les souffrances de l’attachement, même si leur présentation marketing va parfois dans ce sens.
Par ailleurs, je ne me formerais pas à tous les outils. Je me formerais à ceux qui :
- facilitent la synchronisation relationnelle et la réparation des ruptures,
- utilisent la vidéo pour soutenir la mentalisation, la réflexivité, la sensibilité et la synchronie dyadique,
- s’appuient sur la régulation corporelle (respiration, yoga, hypnose, EMDR, massage, etc.),
- soutiennent la reconstruction du récit, le développement de narratifs cohérents (théâtre, écriture, art…),
- et permettent des expériences de lien sans danger, via le jeu et/ou les médiateurs animaux.
Je choisirais les outils les plus réparateurs pour les sujets insécures, pas nécessairement les plus en vogue, ni forcément promus par la recherche empirique — qui n’est pas toujours aussi empirique qu’on le pense. Je les choisirais en fonction de ce que moi, je peux mettre en œuvre, ce avec quoi je suis à l’aise, et qui a montré une efficacité pour les patients.
5. Enfin, et tout le long de ce parcours, je travaillerai à me transformer moi-même
Je travaillerais sur mes propres traumas, mes pertes non résolues, pour vivre moi-même des expériences correctrices de sécurité.
Car nous, professionnels de la santé mentale, ne choisissons pas ce métier par hasard.
Bowlby disait « suffisamment blessé mais pas suffisamment abîmé » (van Dijken, van der Veer, van IJzendoorn, & Kuipers, 1998) pour parler des thérapeutes, et Jung parlait de « guérisseurs blessés » : “Seul le guérisseur blessé guérit… et seulement dans la mesure où il s’est guéri lui-même.” (Jung, C. G., & Hull, R. F. C. (2023). Fundamental Questions of Psychotherapy 1. In Collected works of CG Jung (pp. v16_111–v16_126). Routledge.)
J’apprendrais à :
- réguler mes états internes,
- fonctionner en lien même sous stress,
- communiquer sans me perdre,
- reconnaître les ruptures relationnelles, savoir les réparer,
- tolérer d’être inconfortable, dans le gris, de ne pas savoir, de ne pas pouvoir,
- faire confiance, me protéger autrement, prendre soin de moi,
- sortir de mes propres stratégies d’attachement.
Sans ce travail, aucune intervention clinique attachement infomée ne fonctionne réellement.
Ce que la théorie de l’attachement m’a appris, c’est que si le thérapeute n’est pas conscient de ses propres stratégies d’attachement, s’il ne connaît pas ses propres traumas, s’il n’a pas appris à réguler ses états internes, s’il se défend au lieu d’accueillir, alors il ne peut pas offrir un espace d’intégration au patient.
Au lieu de permettre une transformation, le thérapeute entre alors dans une danse invisible avec la stratégie d’attachement du patient. Il renforce parfois malgré lui ce qui devait changer, et ne peut que difficilement proposer autre chose qu’un écho relationnel déjà connu — et souvent figé — pour le patient.
Ce point, je l’ai mis en dernier. Il aurait dû être le premier. Le tout, tout premier.
Conclusion
Voilà ce que je mes 20 ans de formation ( reçue set données), de pratique me font dire aujourd’hui de ce que serait le parcours idéal de formation d’un cliniciens de l’attachement.
Ce n’est ni un plan de carrière, ni une recette de formation. C’est un chemin d’exploration, de maturation, fait d’observation, de traversée personnelle, de complexification des savoirs.
Ce que j’ai appris dans ce travail autour de l’attachement, c’est que se former à l’attachement, c’est long, transformant, en mille-feuille.
Certaines formations, je les ai faites six fois, et à chaque fois j’apprends quelque chose de nouveau. Parce que je ne peux intégrer certains savoirs en ce qui concerne l’attachement que parce que, dans ma propre histoire d’attachement, je suis prête à les intégrer. Avant, ils ne sont pas vraiment accessibles, je ne les entends pas, ou ne peux pas les utiliser.
Se former à l’attachement, devenir un « attachementiste », ce n’est pas seulement acquérir une grille de lecture, connaître les styles d’attachement, les reconnaître. C’est construire une posture clinique fondée sur la réflexivité, la sécurité intérieure, l’observation relationnelle, et le respect du rythme de chacun.
C’est donc un voyage, un long voyage sans fin que je crois que je continuerai, encore, demain.
Et vous ? Quelle est votre vision de la formation en attachement ? Qu’auriez vous besoin d’apprendre et pourquoi ? Dite moi en commentaire.
Texte publié le 7 juin 2025 dans le cadre du projet A-T-L-A-S : un blog clinique pour explorer les liens qui façonnent l’humain.*
— Alexandra Deprez
Merci pour votre lecture
Merci d’avoir pris le temps de lire cet article.
Si vous avez une question, une réflexion ou une nuance à partager, n’hésitez pas à laisser un commentaire ou m’écrire : vos retours nourrissent mon travail.
Soutenir mon travail
Ce blog est indépendant, sans publicité, et il me demande beaucoup d’énergie pour vous offrir des contenus rigoureux, sensibles et utiles.
👉 Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez m’offrir un café virtuel via Buy Me a Coffee :
Soutenir le blog : [Lire pourquoi et comment ici]
Recevoir la newsletter
Je partage régulièrement des contenus inédits sur l’attachement, la parentalité, les dérives du développement personnel, ou encore le lien entre IA et humanité.
👉 Pour recevoir ces articles directement dans votre boîte mail, inscrivez vous ci dessous.
Se former à la théorie de l’attachement
Vous êtes professionnel·le de la santé, du social ou de l’éducation ?
J’ai conçu une formation complète à la théorie de l’attachement, 100 % en ligne et interactive.

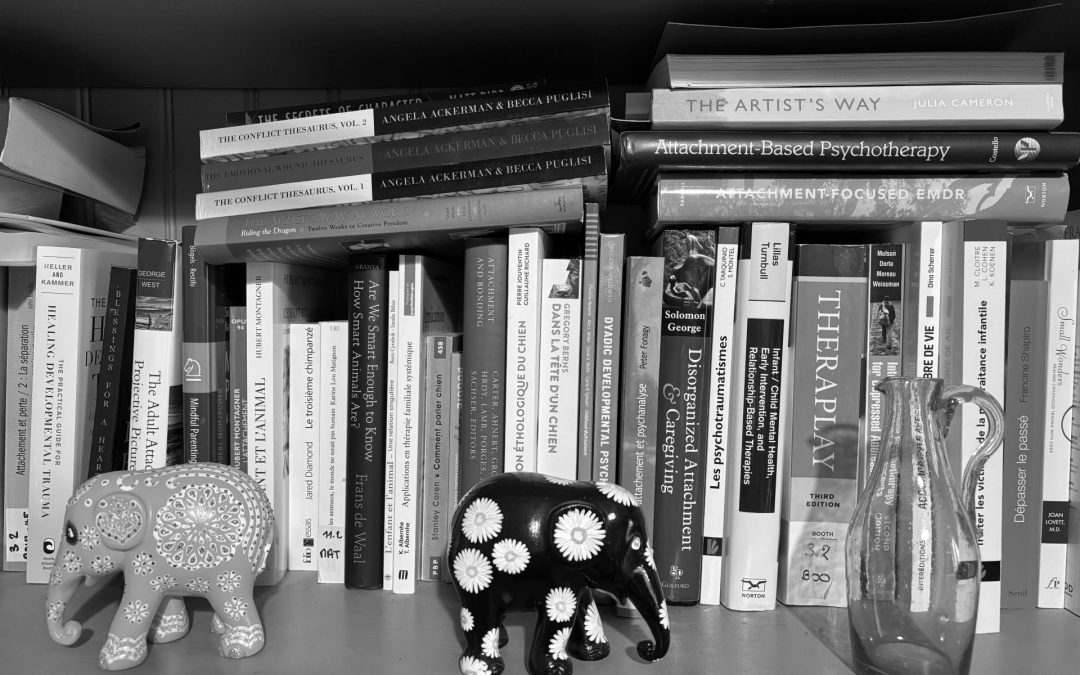
Bonjour,
Merci beaucoup pour cet article profond dans sa rétrospective.
Quelle place faîtes vous ou fait la recherche sur le travail d’attachement en psychothérapie ?
Pour le trauma, on sait que les TCC sont validées (EP,TCP etc) mais pourquoi l’EMDR et les autres interventions que vous citez ? Sont-elles plus adaptées ?
Enfin, la plupart des psychothérapies, TCC y compris, prétendent cibler l’attachement en étant déconnectées de l’état de la recherche. À votre connaissance, est-ce aussi le cas pour l’ICV et les propositions de Joanna Smith ?
Merci !
Bonjour,
Merci pour ce commentaire ! Je suis très contente de pouvoir y répondre. Il y a plusieurs points :
La première chose, c’est que quand on écrit un article de blog, on fait un choix, parce qu’on ne peut pas écrire tout. C’est un peu frustrant d’ailleurs, et vos questions m’offrent l’opportunité d’approfondir, alors merci 🙂
Sur votre premier point, je ne suis pas certaine de bien comprendre :
« Quelle place faites-vous ou fait la recherche sur le travail d’attachement en psychothérapie ? »
C’est Bowlby qui, à la fin de sa carrière, a amorcé la réflexion sur la psychothérapie et l’attachement (et pas vraiment une « psychothérapie de l’attachement »). Je pense qu’il y a beaucoup de subtilités à comprendre.
Les interventions précoces, chez l’enfant jeune, qui visent à promouvoir le développement d’un attachement de meilleure qualité possible, sont pour moi un positionnement juste et clair au regard de la théorie et de la recherche.
Maintenant, une fois que l’attachement est développé, la confusion qui me semble fréquente — et que le DMM de Crittenden ne fait pas —, c’est de considérer l’attachement insécure (on n’a pas d’attachement désorganisé dans le DMM) comme un problème, alors que c’est une solution.
Aujourd’hui, toutes les approches thérapeutiques de l’attachement chez l’adulte postulent que l’attachement insécure est problématique. On cherche donc à changer l’attachement, au lieu de changer les conditions qui l’organisent. Cela part aussi d’un présupposé selon lequel l’attachement serait relativement fixe toute la vie, ce qui est faux. Et surtout, la recherche n’est pas encore très éclairante sur le sujet.
Donc en fait, notre cible en thérapie ne devrait pas être de changer l’attachement, mais de changer les conditions qui l’organisent et le maintiennent. Et ça, on l’a toujours fait ou essayé de le faire en thérapie, je crois. Simplement, la théorie de l’attachement permet de l’expliciter.
Ce que la théorie de l’attachement apporte d’innovant, selon moi, à la thérapie, c’est d’éclairer ce qui, dans les facteurs communs de l’efficacité thérapeutique, est dû au lien avec le thérapeute. Et là, la vraie question, c’est : comment nous, thérapeutes, on change ? Comment notre propre attachement vient aider, ou au contraire entraver, la relation thérapeutique ?
Je n’ai pas la place ici de déployer la recherche à ce sujet, mais je le ferai dans un article de blog : c’est très intéressant. Étonnamment, cette dimension est assez peu, voire pas du tout abordée dans les approches actuelles de thérapie de l’attachement, chez l’adulte comme chez l’enfant.
En conclusion, je crois que la question du « travail d’attachement » en psychothérapie est souvent soit une compréhension partielle de la théorie (et c’est souvent le cas), soit pas vraiment un sujet en soi (il faudrait que j’approfondisse). Je crois que le vrai sujet — et la recherche va aussi dans ce sens, d’une certaine manière —, c’est : qu’en est-il de l’attachement du thérapeute ?
Sur votre deuxième point, je cite l’EMDR parce que c’est ce que je connais. Mais hier, je faisais une revue de la littérature scientifique pour savoir ce qui est sérieusement validé pour la prise en charge des traumas complexes ou développementaux (donc perpétrés par la figure d’attachement). Et oui, les TCC ont un appui empirique sérieux.
Je vais m’atteler à faire un guide. Donc je dirais : je parle de l’EMDR parce que c’est le parcours que moi j’ai fait, mais il s’agit en fait surtout d’avoir une méthode de prise en charge des traumas complexes qui soit empiriquement validée, pour s’assurer de ne pas avoir d’effet iatrogène.
Sur votre troisième point, pour être franche, je suis perplexe en ce moment. J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de confusion dans les tentatives pour combler le gouffre entre la recherche et les applications cliniques de la théorie de l’attachement.
Par exemple, quand je me suis formée à l’EMDR niveau 2 (enfant et adulte), à Theraplay niveau 2 (directement au Theraplay Institute), ou en intervention relationnelle, on « intègre » la dimension de l’attachement — mais à chaque fois, j’étais vraiment interpellée par la présentation succincte, caricaturale, de la théorie de l’attachement.
Comme si l’opérationnalisation clinique ne pouvait se faire qu’en appauvrissant la théorie. Et puis, il y a une méconnaissance importante de la faible portée empirique des résultats de recherche, en réalité. On ne sait finalement pas tant de choses que ça…
Bref, l’ICV ne fait pas exception pour moi. Je connais Joanna, j’apprécie sa compétence clinique. Je ne suis pas moi-même formée à l’ICV, mais j’ai regardé la recherche. Il n’y a pas grand-chose (je pourrais faire un article là-dessus à un moment), et surtout, il n’y a pas de données empiriques solides qui montrent une efficacité sur le trauma complexe ou sur l’attachement.
À choisir, je mets mes sous dans une formation EMDR.
On a aussi ce problème avec Theraplay. La recherche — qui n’est pas non plus très solide — montre des effets sur les comportements des enfants, mais les méthodes sont fragiles, les échantillons petits, et surtout, il n’y a aucune recherche faite avec des évaluations d’attachement solides.
Donc clamer qu’on change l’attachement, sans preuve empirique… c’est un problème selon moi.
Après, tous ces modèles sont « informés par l’attachement », c’est-à-dire que la théorie a contribué à penser ce qui est proposé comme intervention. Donc ce n’est pas du n’importe quoi non plus. Mais je crois qu’on grossit souvent le trait, et qu’on embellit un peu la validation empirique — et je crois que l’ICV, mais pas seulement, est dans ce cas.
Pour finir, je ne suis pas certaine qu’on ait besoin de créer des modèles thérapeutiques qui visent spécifiquement à changer l’attachement chez l’adulte (chez le jeune enfant, c’est autre chose).
Je crois qu’on a surtout besoin de comprendre ce qui, dans le lien thérapeutique — quel que soit le modèle —, relève de l’attachement. Et notamment celui du thérapeute. Et comment cela va permettre de faire figure d’attachement transitoire pour un sujet qui doit apprendre d’autres manières de s’adapter à son environnement, ou qui doit trouver les ressources pour changer son environnement.
C’est dit à grands traits là, mais si ça intéresse, ce pourrait être le sujet d’une belle discussion ou d’une masterclass en ligne 🙂
Merci en tout cas, et je serais heureuse de continuer la discussion.
Alexandra
Bonjour,
Merci encore pour votre réponse très détaillée et complète. Désolé j’ai écrit mon commentaire tôt le matin sur portable, j’ai manqué de clarté.
En fait ma première question revenait à demander : quels sont les acquis de la recherche sur l’attachement qui ont été opérationnalisés en pyschothérapie ?
Ensuite, votre nuance sur les conditions d’organisation de l’attachement et l’attachement en tant que tel ne m’a jamais été enseignée donc merci pour cet éclairage.
Pour votre réponse sur la réticulation plutôt inexistante entre la recherche sur l’attachement et les psychothérapies, je pense aussi que le contexte français avec un arrêt de la théorie par « auteurs » (Bolwby, Cyrulnik, Bergeret etc), une confusion entre relation (notamment en psychanalyse française) et attachement et la séparation presque ontologique entre recherche et clinique renforce encore plus la caricature de la théorie de l’attachement.
Comme pour les neurosciences et la psychopathologie cognitive, les psychothérapies fondées sur les preuves gagneraient à valider un socle théorique cohérent avec la théorie de l’attachement dans ce cas (thérapie des schémas, EMDR etc) ! Encore plus si elles avancent mettrer la sécurité relationnelle comme principe actif de la thérapie.
En tout cas, la possibilité que vous évoquez de spécifier l’efficacité de l’alliance thérapeutique et d’être un processus réflexif en séance même afin de façonner du changement me fait beaucoup penser aux interventions comportementales (le concept d’arène 1 et arène 2 par Thorneke) en ACT dans la relation thérapeutique et surtout en FAP qui va se centrer sur la relation thérapeute-client pour apprendre d’autres comportements.
Bien à vous
Bonjour,
Merci pour ce retour nuancé — je vois mieux ce que vous cherchiez à interroger, et je vous rejoins sur beaucoup d’éléments.
Ce que vous dites sur le contexte français (la lecture par auteur, la confusion relation/attachement, la séparation entre théorie et pratique) est très juste, et j’y suis souvent confrontée aussi.
Ce que j’essaie de faire dans mes formations, c’est justement de proposer une interface solide et critique entre la théorie de l’attachement (notamment le DMM) et les pratiques thérapeutiques — sans prétendre créer un nouveau modèle, mais pour aider les cliniciens à penser autrement ce qu’ils font déjà.
Je trouve intéressant le lien que vous faites avec la FAP ou les processus d’ACT — c’est une piste à creuser, car ces modèles-là que je connais mal sembllent prendre au sérieux la dimension relationnelle dans la transformation. Peut-être que c’est là que le dialogue peut se renforcer.
Merci encore pour cet échange, il nourrit ma réflexion.
Alexandra