Réflexion sur l’inflation sémantique de la notion de trauma et les réponses théoriques du DMM
Résumé:
On parle beaucoup de trauma. Peut-être trop.
À tel point que le mot semble avoir perdu sa force, sa fonction, sa précision.
Ce glissement n’est pas sans conséquences : dans nos pratiques, dans nos diagnostics, dans notre rapport même à la souffrance humaine.
- Comment distinguer une détresse intense d’un effondrement adaptatif ?
- Que faire quand le mot “trauma” devient si large qu’il n’explique plus rien ?
- Et s’il était temps de remettre à plat nos cadres de pensée ?
Dans cet article, je propose une relecture critique de la notion de trauma à partir du modèle dynamique-maturationnel de l’attachement (DMM) de Patricia Crittenden.
Ce modèle offre une perspective précieuse pour comprendre ce qui a été appris — et comment le cerveau, sous stress, tente de survivre coûte que coûte, et finalement est ce que l’on a vraiment besoin du mot “trauma”.
Pour les professionnels en quête d’une clinique plus rigoureuse, plus nuancée, plus respectueuse des stratégies adaptatives.
Plan de l'article
Introduction:
Depuis quelques années, j’observe que la référence à la notion de trauma en psychologie clinique et en psychiatrie est de plus en plus fréquente. Si l’on ne peut qu’approuver l’accès à l’information pour les personnes souffrant à cause du trauma, il existe cependant des effets pervers de la diffusion scientifique dont il convient de prendre conscience. En effet, connaître et comprendre les risques associés à la vulgarisation scientifique nous permet de nous y préparer et de contrer les effets délétères éventuels auprès de la population. L’inflation sémantique de l’utilisation du concept de trauma est un exemple patent de ce type de problématique. Il m’intéresse particulièrement parce que les champs de la théorie de l’attachement et de la psychotraumatologie sont de plus en plus liés en clinique et s’influencent l’un l’autre. Ainsi, les défauts de vulgarisation de l’un peuvent influencer l’autre, et inversement, générant un flou conceptuel qui, en tout cas en ce qui me concerne, parasite mon travail clinique. Dans cet article, je présenterai et illustrerai ce que l’on entend par inflation sémantique du concept de trauma, j’en expliquerai les conséquences possibles, celles qui ont un impact selon moi sur notre travail clinique et sur les patients, et enfin, je ferai le lien avec la théorie de l’attachement. M’appuyant sur la pensée de Crittenden, j’expliquerai comment cette dernière conçoit et précise la notion de trauma, les liens avec l’adversité, le risque de PTSD, les stratégies d’attachement et le risque de psychopathologie. Cette conception change le paradigme théorique sur lequel on s’appuie pour penser l’expérience traumatique des individus, et nous verrons qu’elle apporte une clarté conceptuelle tout à fait pertinente pour la clinique, et surtout, pour le diagnostic en psychopathologie.
Quand tout est trauma, qu’est ce qui est trauma exactement?
Cette question me trottait dans la tête depuis un moment, mais elle est venue au premier plan de ma réflexion ces derniers mois, lorsque je suis tombée sur l’article de Baer, Vylomova, Zuphur et Haslam (2023) intitulé “The Semantic Inflation of Trauma in Psychology”.
Des auteurs pensaient comme moi, ils abordaient explicitement la question en publiant sur le sujet, et mieux encore, déployaient une recherche qui validait l’intuition. Je ne pouvais pas ne pas m’y intéresser. En même temps, je ne suis pas tombée par hasard sur cet article : je cherchais sur Google Scholar si, comme moi, d’autres auteurs – plus expérimentés, plus légitimes – relevaient ce phénomène d’inflation de la notion de trauma.
Car, je l’espère, vous l’aurez remarqué : on ne parle plus que de trauma.
Dans les formations, dans les livres, dans les conférences, dans les publications scientifiques ou de vulgarisation grand public – et sur les réseaux sociaux, n’en parlons pas…
C’est aussi le résultat du travail de très grands cliniciens qui se sont attelés à la tâche de ramener au premier plan de la clinique et de la psychopathologie cette notion. Je parle ici, bien entendu, de Bessel van der Kolk, Shapiro, Levine, Gabor Maté, Bruce Perry, mais aussi de la diffusion à grande échelle des résultats des études ACE, qui sont édifiantes.
À première vue, l’éducation du public sur la notion scientifique de trauma et sur les effets des adversités sur la santé est salutaire. Elle libère la parole, permet de rendre la société consciente de la souffrance des victimes, elle permet aux victimes d’être reconnues, prises en charge, elle soutient le développement de politiques publiques financées, d’interventions efficaces…
Bref, c’est essentiel – et loin de moi l’idée de dire qu’il ne faudrait pas communiquer auprès du grand public sur les résultats de la recherche en psychopathologie et en psychologie clinique.
Mais en même temps, je crois qu’il faut avoir conscience que, insidieusement, plus on communique, plus on vulgarise, plus les concepts s’élargissent, se brouillent, se diluent.
Plus le grand public s’empare du savoir scientifique, plus ce dernier perd sa puissance sémantique, en quelque sorte.
C’est ce que démontrent les auteurs de l’article que j’ai cité ci-dessus, en identifiant l’existence de deux phénomènes d’inflation sémantique qui s’exercent actuellement sur la notion de trauma.
Les mécanismes d’inflation sémantique de la notion trauma
1 – L’expansion horizontale
L’expansion horizontale désigne l’élargissement du champ d’application d’un concept à des situations ou des contextes qui n’étaient pas initialement inclus. Cela signifie concrètement que l’on applique un concept – ici, le trauma – à un plus grand nombre de cas. (On pourrait faire des constats similaires, je pense, pour la désorganisation ou le trouble de l’attachement, l’autisme, le TDAH, la dépression…)
Ainsi, à l’origine, le terme trauma était réservé (dans les premières versions du DSM, par exemple) aux situations extrêmes mettant en danger la vie ou l’intégrité du sujet (guerre, viol, catastrophe naturelle, agression).
Aujourd’hui, cette conception est toujours incluse, mais la notion s’est élargie : une relation toxique, un licenciement, une rupture amoureuse, des adversités qui ne mettent pas en cause la survie ou l’intégrité du sujet vont être qualifiées de traumatiques.
Il ne s’agit pas ici de dénier que ces expériences sont douloureuses et que la souffrance vécue par le sujet est authentique, mais elles n’impliquent pas nécessairement un effondrement du système adaptatif.
2 – L’expansion verticale
Il s’agit ici de l’élargissement du concept par un changement de niveau de profondeur ou de gravité que le concept recouvre.
Ainsi, en ce qui concerne le trauma, des expériences perçues autrement comme douloureuses mais « mineures » au regard du risque réel pour le sujet sont désormais considérées comme ayant un impact profond, délétère, souvent invisible et/ou d’expression retardée dans la vie du sujet.
À l’origine, l’événement traumatique devait être suffisamment grave pour que la majorité des êtres humains confrontés à cette expérience éprouve une détresse intense, non résoluble, au-delà de l’expérience humaine normale, toutes sociétés, cultures et époques confondues.
Cette conception s’est assouplie pour inclure aujourd’hui des variantes de l’expérience humaine qui étaient certes difficiles, stressantes, ou développementalement inappropriées, mais sans forcément mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle.
Ces mécanismes d’inflation sémantique, qui résultent du besoin humain compréhensible et fondamental de faire sens de son expérience, ont plusieurs implications, notamment cliniques.
Les implications de l’inflation sémantique de la notion de trauma
La première, c’est celle qui est dans le titre de cet article : quand tout est trauma, alors rien n’est trauma.
Ce qui se produit avec l’inflation sémantique, c’est que l’outil sémantique — le mot — est rendu incapable de rendre compte de la réalité. Cela impacte la communication, le moyen de faire sens ensemble, le code qui relie nos représentations. Mais cela impacte aussi la conception de ce qu’est une victime, car tout le monde devient victime.
Mais peut-on vraiment « comparer » l’expérience des victimes de violences sexuelles ou de guerre à celle de personnes ayant eu des parents trop rejetants, ou ayant vécu un divorce — même si ce divorce a été extrêmement difficile ?
Comme, effectivement, ce ne sont pas les mêmes expériences, ni les mêmes défis cliniques ou d’adaptation pour le sujet, on est alors obligé de surenchérir sémantiquement. Et c’est ainsi que l’on a vu émerger les notions de trauma complexe, ou de trauma développemental, et leur propre inflation.
Deuxièmement, dans le champ de la santé mentale — qui est celui des représentations mentales qui organisent nos comportements, notre perception de nous-mêmes et du monde — les mots peuvent créer les problèmes.
En effet, une particularité de la sémantique en psychologie, c’est qu’elle est performative.
Un terme performatif ne se contente pas de décrire la réalité : il la façonne, il produit ce qu’il nomme, ou le transforme en étant prononcé.
Ainsi, dire d’une personne qu’elle est traumatisée, ou que tel événement de sa vie a dû être traumatique, la transforme instantanément en victime, et lui fait vivre un sentiment d’impuissance — car c’est ce que le mot trauma porte en lui au plan des représentations.
Le mot organise alors la perception que le sujet a de lui-même, de son histoire, du monde, ses attentes, son comportement, son rapport à la souffrance. Ce n’est donc pas neutre.
Donc, si on utilise de plus en plus largement un concept de psychopathologie comme celui de trauma, on crée — en quelque sorte — autant de diagnostics, autant de sujets qui s’identifient comme victimes, autant de besoins d’aide, de soutien.
Et s’il peut y avoir des effets positifs pour des personnes réellement traumatisées qui reçoivent ainsi un terme qui les aide à penser leur expérience, il peut aussi y avoir des effets négatifs — et créer des “fausses victimes”.
Troisièmement, l’inflation sémantique génère un changement de critères de détermination.
Le mouvement d’inflation de l’utilisation du terme trauma change la façon dont on identifie, diagnostique le trauma.
Aujourd’hui, c’est davantage la souffrance dont témoigne le sujet, générée par l’événement, que l’événement lui-même, qui “fait trauma”.
C’est peut-être une bonne chose — je ne suis pas forcément suffisamment experte du trauma pour conclure sur ce point — par contre je sais que c’est à ce niveau que se produit la collision avec la théorie de l’attachement, modèle DMM, parce que :
Pour le DMM, le danger est normal. Nous sommes les descendants d’humains qui ont survécu à toutes sortes de dangers. Nous sommes adaptéspour survivre aux dangers. Alors qu’est-ce qui est danger, adversité, trauma ?
Pour le DMM, le trauma désorganisecar il sature le système adaptatif. Si tous les dangers génèrent de la souffrance — qui est par ailleurs le signal nécessaire pour déclencher le système adaptatif — qu’est-ce qui caractérise les dangers qui submergent ce système et compromettent la survie ?
Les stratégies d’attachement — surtout les stratégies insécures — sont des adaptations apprises au cours des expériences dangereuses, conçues pour promouvoir la survie, l’adaptation au contexte adverse, à la crise, au stress, au danger.
Certaines de ces stratégies reposent sur une exagération inconsciente mais fonctionnelle de la vulnérabilité, d’autres sur des processus dissociatifs massifs, d’autres enfin sur une activation combattante, agressive.
Toutes sont des traces du système adaptatif en action, toutes ayant été fonctionnelles pour la survie à un moment donné — et gardées en mémoire au cas où.
Alors, comment faire la distinction entre l’expression de ces stratégies fonctionnelles, adaptatives — même si elles semblent symptomatiques — et la désorganisation traumatique ?
Dans les deux cas, le sujet souffre et est en détresse.
Mais dans un cas, il a une stratégie d’adaptation coûteuse mais fonctionnelle, dans l’autre, il n’en a pas.
La théorie de l’attachement fait la distinction entre les traumas résoluset les traumas non résolus.
Seuls les traumas non résolus sont un problème, car ils empêchent la stratégie d’attachement — sécure ou insécure — de fonctionner.
Donc, du point de vue de la théorie de l’attachement, il y a une typologie des traumas qui n’ont pas les mêmes effets sur le sujet, et ne requièrent pas les mêmes actions cliniques.
Mais simultanément, du point de vue de la psychotraumatologie, les stratégies d’attachement extrêmes sont considérées comme du trauma actif, inadapté, qualifié de trauma complexe ou développemental, déniant en cela la dimension fonctionnelle de survie de ces stratégies.
J’espère que vous me suivez, et que vous voyez comme moi toutes les frictions qu’il peut y avoir autour de cette notion de trauma, et le flou sémantique qui l’accompagne désormais.
Recentrons le problème avec Crittenden
Si ce n’est pas l’événement, l’adversité, le danger qui caractérisent le trauma, mais la réaction du sujet aux expériences difficiles ou dangereuses, alors quelles sont les caractéristiques, les indicateurs qui vont nous, cliniciens, nous permettre de déterminer quand une intervention est nécessaire, quand un diagnostic est requis ?
Comment distinguons-nous l’adversité normale de la vie du trauma, si les critères de survie et d’intégrité ne sont plus la base ?
Le tableau se complexifie encore lorsqu’on considère que, selon les stratégies d’attachement développées au cours de l’enfance — surtout chez les sujets avec des attachements insécures — l’information venant du sujet, son expression de la souffrance, sont transformées et ne sont pas fiables.
On se rend compte que tout le champ sémantique de la psychopathologie se trouble :
L’inflation de la notion de trauma trouble celle de PTSD, celle de trauma développemental, complexe, celle de souffrance, de détresse, d’adversité, de trouble de l’attachement, de désorganisation de l’attachement, d’insécurité, de sécurité…
En tout cas, c’est ce que moi j’éprouve.
Même la symptomatologie, y compris somatique, ne suffit plus à poser un diagnostic, puisque la dissociation, dans la théorie de l’attachement, peut être adaptative et fonctionnelle, mais est pathologique pour la psychotraumatologie. L’expression de la détresse aussi.
Comment faire ? C’est ici que la pensée de Patricia Crittenden prend toute son importance, et porte toute sa puissance.
Elle propose en effet une lecture que je trouve aidante, une conception de l’adaptation à la crise qui permet de rétablir un champ sémantique utile, une dimension du normal au pathologique, et d’articuler la souffrance du sujet avec l’ensemble des processus de l’adaptation à la maladaptation.
Sa pensée s’organise autour de plusieurs particularités :
Une économie et une précision sémantiqueà toute épreuve.
Les termes, les concepts sont définis avec rigueur, et leur définition n’évolue que peu ou pas.
Ainsi, sécurité, insécurité de l’attachement, désorganisation, etc. n’ont pas la même acceptation que dans la compréhension générale.
Le traitement de l’information à visée adaptative, pour promouvoir la survie, est le seul et unique niveau d’analyse.
Donc pas le discours, pas le symptôme, pas le comportement, pas l’émotion éprouvée ou exprimée, pas l’environnement isolé, mais l’interaction de tous ces facteurs dans le traitement de l’information.
Le développement, l’attachement, la fonction des figures d’attachementsont pris en compte dans la conception de l’adaptation au danger.
Le danger est normal— je le répète — et il organise le comportement.
Si nous devions nous désorganiser au moindre danger, nous n’aurions pas survécu en tant qu’espèce. Le modèle DMM est un modèle fondé sur les ressources.
Dans son chapitre “Toward an Integrative Theory of Trauma” ( danger, development et Adapration, crittenden (2015), elle propose une théorisation de l’adaptation des individus confrontés au danger et démontre que le concept de trauma n’est pas conceptuellement valable.
Pour elle, ce qui importe, ce sont les processus adaptatifs (ou leur échec) face au danger, et elle propose un continuum de l’adaptation à la maladaptation, en lien avec l’attachement et le traitement de l’information.
Il faut ici rappeler que, pour Patricia Crittenden, l’attachement est :
certes une relation, spécifique, continue, durable,
mais surtout une stratégie de protection de soi face au danger (de son partenaire, de sa progéniture),
ainsi que les patterns neuronaux qui organisent le comportement.
1. Il n’y a pas « un trauma » : il y a une réaction adaptative à une crise
Elle ne part ni de l’événement, ni de la souffrance subjective seule.
Elle part de la question :
Comment l’individu traite-t-il l’information en situation de danger ? Que se passe-t-il quand ce traitement échoue ? Qu’apprend-il ? Comment ? Pourquoi ? Ce qui est appris va-t-il promouvoir la survie, l’adaptation — ou non ?
2. Les stratégies défensives (attachements insécures A/A+ ou C/C+) sont des formes d’adaptation fonctionnelle à des dangers chroniques
Les stratégies A et C sont des réponses fonctionnelles à des contextes dangereux où la stratégie B (sécure) n’a pas pu être utilisé, apprise.
Elles ne sont pas des pathologies, mais des modes de survie, avec leurs coûts.
3. Si une stratégie insécure ne suffit pas, le système peut osciller (A/C)
Quand les stratégies A ou C ne suffisent pas à résoudre le danger, à apporter protection et réconfort — par exemple face à des dangers contradictoires, imprévisibles, ou incohérents — l’individu peut osciller entre les deux types de stratégie et les garder simultanément dans son répertoire, pour augmenter ses chances d’adaptation et de survie.
Ce qui est perçu comme comportement désorganisé est, pour le DMM, hautement organisé.
Si l’oscillation entre les stratégies A/C ne parvient pas à apporter protection et confort, alors le risque est infiniment plus grand :
c’est l’adaptation elle-même qui est compromise — donc la survie.
4. Le PTSD, compris comme un échec des stratégies défensives
Quand toutes les stratégies défensives possibles échouent, le système d’adaptation se désintègre.
C’est là, et seulement là, que surgissent le risque le plus important de psychopathologie.
Le PTSD est le premier signe : le système adaptatif tourne à vide.
Différentes stratégies adaptatives sont activées compulsivement, simultanément mais en échec chronique. Il n’y a ni protection, ni réconfort face au danger et à la détresse, ou en tout cas pas de façon durable.
5. Les tentatives extrêmes… puis la renonciation
L’aggravation de ce tableau, c’est le désespoir : l’arrêt des tentatives de s’auto-protéger.
C’est un état affectif extrême, une dernière chance de communiquer à l’environnement le besoin de protection et de réconfort. Le sujet n’essaie plus de s’en sortir seul, mais dans un dernier élan tente de provoquer un changement dans la réponse de l’environnement.
À ce stade, l’espoir est encore présent — mais le coût biologique est immense car il signale ouvertement la vulnérabilité extrême. Cet état ne peut pas durer longtemps sans danger pour l’intégrité physique et la survie, surtout chez le jeune enfant.
Si le désespoir échoue à produire une réponse protectrice de l’environnement, alors s’installe ce que Crittenden appelle la dépression — pas au sens clinique courant, mais au sens d’un retrait complet, d’une renonciations aux tentatives de communication avec le monde.
Le sujet se met en position économique d’attente, se ralentis et simultanément lerecentrage extrême sur le soi, avec les ruminations qui l’envahissent, peut être une dernière tentative de trouver la solution, en concentrant toute l’énergie restante sur la réflexion.
Mais cet état place le sujet dans une vulnérabilité extrême : il ne surveille plus ou mal son environnement.
Si le danger est physique et non émotionnel, il est incapable de se protéger.
Et si aucune solution ne fonctionne, que le danger reste imminent, alors la biologie adaptative s’épuise.
Quand le sujet croit qu’il n’y a plus rien qui peut le protéger, physiquement ou émotionnellement, l’impuissance apprise s’installe.
À ce stade, les efforts pour survivre cessent.
Avons nous besoin du mot “trauma” ?
Pour Crittenden, le mot “trauma” est, en quelque sorte, superfétatoire
Il devient redondant.
Elle le garde parce qu’il est socialement utilisé, mais elle en vide le contenu sémantique.
Elle le remplace par :
un modèle développemental du danger,
une typologie des adaptations,
une attention portée au traitement de l’information,
un repérage clinique de l’effondrement adaptatif.
Et donc, la question clinique centrale devient :
Où en est le sujet dans son système adaptatif ? Est-il encore capable de chercher protection et réconfort, ou son système est-il submergé ?
Ce qui est intéressant dans cette conception, c’est que :
On n’a plus besoin des notions de trauma, trauma développemental, trauma complexe.
Ce n’est plus ni l’événement, ni la souffrance du sujet qui fait diagnostic, mais l’organisation fonctionnelle du comportement, donc le traitement de l’information associé — ce qui a été appris, retenu.
Tout mécanisme défensif (y compris la dissociation) est à comprendre dans sa fonction adaptative, avant toute intervention, au risque de fragiliser le sujet.
Ce continuum est valable à tous les âges, dans toutes les cultures.
Les stratégies d’attachement insécures sont des ressources, à respecter.
Cela explicite clairement, chez l’enfant, la fonction de la figure d’attachement comme tampon entre le danger et lui.
Et que son comportement, en lien avec sa stratégie, est le moyen d’obtenir protection et réconfort.
Cela clarifie les processus diagnostiques et les indications de prise en charge à tous les âges.
Le comportement devient un indicateur de l’état du système adaptatif.
Il raconte l’histoire des dangers rencontrés et de leurs caractéristiques.
Il témoigne du traitement de l’information utilisé sous stress pour se protéger.
Il indique si ce traitement est adaptatif ou non, coûteux ou non.
Il permet d’évaluer le degré de proximité avec l’effondrement du système adaptatif.
Et surtout, c’est une approche fondée sur les ressources.
Enfin, cette approche élimine les effets délétères de l’inflation sémantique.
Un tableau pour résumer: Le continuum des réponses au danger selon Crittenden.
| Étape | Nom du niveau | Type de stratégie / fonctionnement | Caractéristiques principales | Risque psychopathologique |
| 1️⃣ | Résolution adaptative (Stratégie B) | Traitement intégré de l’informationAttachement sécurisé | Le danger est compris, régulé, encodé en mémoire. L’enfant apprend pour le futur. La figure d’attachement soutient. | Aucun : souffrance sans trauma |
| 2️⃣ | Stratégie défensive unique (A ou C) | Traitement partiel / orienté (inhibition ou amplification) | L’enfant s’adapte sans aide suffisante. Il organise seul ses réponses. Stratégies efficaces mais rigides. | Faible à modéré, dépend du contexte |
| 3️⃣ | Alternance stratégique (A/C) | Passage instable entre les deux stratégiesIncohérence adaptative | Le système tente plusieurs voies. Comportements contradictoires. Risque d’épuisement adaptatif. | Modéré à élevé |
| 4️⃣ | Stratégies échouées (PTSD) | Débordement du système adaptatif | Le traitement de l’information échoue. L’événement reste non intégré. Symptômes dissociatifs, reviviscences, etc. | Élevé |
| 5️⃣ | Désespoir | Effondrement de la représentation du monde sécurisable | La personne n’attend plus de solution. Le danger paraît permanent. Inhibition, passivité, retrait. | Très élevé |
| 6️⃣ | Dépression | Chronicisation du désespoir | Perte d’énergie, perte de désir, anesthésie émotionnelle. Le système adaptatif s’éteint progressivement. | Très élevé |
| 7️⃣ | Impuissance acquise (Learned Helplessness) | Échec global de l’adaptationPerte d’agentivité | Plus aucune tentative de réponse. Le sujet abandonne toute tentative d’action. Risque vital parfois engagé. | Extrême / pronostic sévère |
À retenir pour le clinicien :
Tout comportement n’est pas un symptôme.
Toute stratégie défensive n’est pas une pathologie.
Le “trauma véritable” commence là où l’adaptation s’effondre.
La lecture développementale et attachement-informée permet de remettre du sens et du mouvement dans ce qui paraît figé ou incompréhensible.
Un processus qui fonctionne dans les deux sens : penser la résilience
Cette conception dimensionnelle n’est pas seulement un outil pour repérer les niveaux de vulnérabilité.
Elle est aussi, à mes yeux, une grille puissante pour comprendre ce qui protège, ce qui permet à certains de ne pas sombrer malgré la violence des épreuves, ce qui constitue en somme le socle de la résilience.
Car le type de stratégie d’attachement développée dans l’enfance, et la manière dont le cerveau a appris à traiter l’information en contexte menaçant, façonnent la réponse future aux crises.
Si, enfant, j’ai eu accès à une figure d’attachement qui m’a protégée, apaisée, aidée à donner sens à l’événement, alors j’ai vraisemblablement développé une stratégie B, avec une capacité à intégrer des expériences émotionnelles complexes, à discerner le danger réel, à demander de l’aide et à réguler mon activation.
Autrement dit : ma base de données interne est riche, organisée, mobilisable.
Si, à l’âge adulte, je traverse une crise majeure, cette organisation me protège. Même si je souffre, même si l’épreuve est réelle, j’ai plus de chances de rester dans une réponse adaptative : je sais que le danger peut être limité, que des solutions existent, que d’autres peuvent m’aider.
Mon cerveau sait encore apprendre.
Et ce raisonnement est valable à tous les niveaux du continuum :
Une personne ayant développé une stratégie A pourra, face à un stress prévisible, continuer à inhiber ses affects de manière efficace — et donc avoir un fonctionnement relativement adaptatif, sauf si les dangers de l’environnement deviennent trop imprévisibles.
Dans ce cas, trois voies s’ouvrent :
celle de la découverte de stratégies de type C, qui peuvent résoudre le problème ;
celle de l’intégration (peu probable sans aide) ;
celle de l’échec des stratégies, avec le tableau désespoir, dépression, impuissance apprise.
Une personne en stratégie C saura mobiliser l’hyperactivation pour chercher du soutien, parfois maladroitement, mais cela peut suffire à éviter l’effondrement.
Mais parfois, même cette stratégie — pourtant d’une efficacité adaptative redoutable, mais souvent mal considérée (on apprécie peu les comportements liés aux stratégies de type C dans la culture occidentale) — peut échouer à apporter protection et réconfort.
Là aussi, comme pour les stratégies de type A/A+, les trois autres voies adaptatives s’ouvrent.
Il existe aussi la solution de la stratégie mixte A/C, qui peut, elle aussi, être fonctionnelle ou non selon les contextes.
Conclusion
C’est pourquoi je pense que notre rôle de clinicien, si l’on opérationnalise la pensée de Crittenden, est d’abord de repérer les dangers qui organisent le comportement (davantage que les symptômes) ; de comprendre le traitement de l’information effectué sous stress, car il nous indique ce qui a été appris et la stratégie défensive mise en place — et donc d’identifier les compétences adaptatives encore actives, même si elles sont discrètes, défensives ou coûteuses.
Ce sont elles qui peuvent servir de point d’appui pour reconstruire un traitement de l’information plus fluide, plus intégratif, au sein de la relation d’attachement transitoire qu’est la psychothérapie.
Enfin, cela permet de repérer et différencier les états de détresse, de dépression, d’impuissance apprise, car ils signalent des dangers extrêmes et la vulnérabilité du sujet, qui requièrent protection et réconfort immédiats.
J’ai conscience, en l’écrivant, de la complexité de cet article.
J’espère que je ne vous ai pas perdu… (Si vous êtes encore en train de lire maintenant, c’est que je n’ai pas fait un trop mauvais travail de pédagogie sur ces idées complexes. Sinon, vous avez sans doute changé de page internet depuis un moment !)
Écrire cet article m’a permis d’ancrer cette conceptualisation, qui pourrait bénéficier d’un développement encore plus approfondi — mais ce serait alors l’objet d’un livre, et non d’un article de blog.
Alors, quels sont les points à retenir, fondamentalement ?
Tout ce qui est potentiellement traumatique est attachement, pour le DMM.
Si l’attachement est la conception de comment on survit, se protège, alors on n’a plus besoin de la notion de trauma : le DMM a théorisé l’ensemble des processus.
Le DMM est un nouveau modèle intégratif pour comprendre l’origine de la psychopathologie et des comportements mal adaptés.
C’est un retour aux origines de la théorie de l’attachement, car cette conception s’appuie fondamentalement sur la pensée de Bowlby et Robertson : la description des effets de la séparation chez l’enfant, les processus de détresse, désespoir, détachement, dépression et impuissance apprise, et surtout le traitement de l’information comme base de lecture et d’analyse — et non simplement le comportement. Le danger est vu comme organisateur du comportement.
Enfin, le DMM éclaire toute la pertinence de la théorie de l’attachement pour la compréhension du développement du risque de psychopathologie, en lien avec l’adversité et les relations — dans toutes les cultures et à tous les âges de la vie.
📚 Références bibliographiques
Baer, R. A., Vylomova, E., Zuphur, R., & Haslam, N. (2023).
The semantic inflation of trauma in psychology. Clinical Psychology Review, 104, 102276. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2023.102276
Crittenden, P. M. (2015).
Toward an integrative theory of trauma: A Dynamic-Maturational Approach. In P. M. Crittenden et al. (Eds.), Danger, development and adaptation: Seminal papers on the dynamic-maturational model of attachment and adaptation (pp. 407–442). Roma: Stefano Guidi.
Van der Kolk, B. A. (2014).
The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma. Viking.
Levine, P. A. (1997).
Waking the tiger: Healing trauma. North Atlantic Books.
Shapiro, F. (2001).
Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Basic principles, protocols, and procedures (2nd ed.). Guilford Press.
Maté, G. (2022).
The myth of normal: Trauma, illness, and healing in a toxic culture. Avery.
Perry, B. D., & Szalavitz, M. (2006).
The boy who was raised as a dog: And other stories from a child psychiatrist’s notebook. Basic Books.
Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., Koss, M. P., & Marks, J. S. (1998).
Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. American Journal of Preventive Medicine, 14(4), 245–258. https://doi.org/10.1016/S0749-3797(98)00017-8
Texte publié le 10 août 2025 dans le cadre du projet A-T-L-A-S : un blog clinique pour explorer les liens qui façonnent l’humain.*
— Alexandra Deprez
Merci pour votre lecture
Merci d’avoir pris le temps de lire cet article.
Si vous avez une question, une réflexion ou une nuance à partager, n’hésitez pas à laisser un commentaire ou m’écrire : vos retours nourrissent mon travail.
Soutenir mon travail
Ce blog est indépendant, sans publicité, et il me demande beaucoup d’énergie pour vous offrir des contenus rigoureux, sensibles et utiles.
👉 Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez m’offrir un café virtuel via Buy Me a Coffee :
Soutenir le blog : [Lire pourquoi et comment ici]
Recevoir la newsletter
Je partage régulièrement des contenus inédits sur l’attachement, la parentalité, les dérives du développement personnel, ou encore le lien entre IA et humanité.
👉 Pour recevoir ces articles directement dans votre boîte mail, inscrivez vous ci dessous.
Se former à la théorie de l’attachement
Vous êtes professionnel·le de la santé, du social ou de l’éducation ?
J’ai conçu une formation complète à la théorie de l’attachement, 100 % en ligne et interactive.
Copyright © 2025 Alexandra Déprez-
Tous droits réservés. Aucune partie de ce site web, à l’exception des brèves critiques et des liens vivants vers ce site web, ne peut être copiée ou utilisée sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit. Toute utilisation doit faire apparaître de façon claire et évidente l’attribution à Alexandra Deprez à l’adresse alexandradeprez.fr.L’utilisation de ce contenu par des systèmes automatisés d’intelligence artificielle à des fins d’entraînement, d’imitation ou de génération est strictement interdite sans autorisation écrite préalable

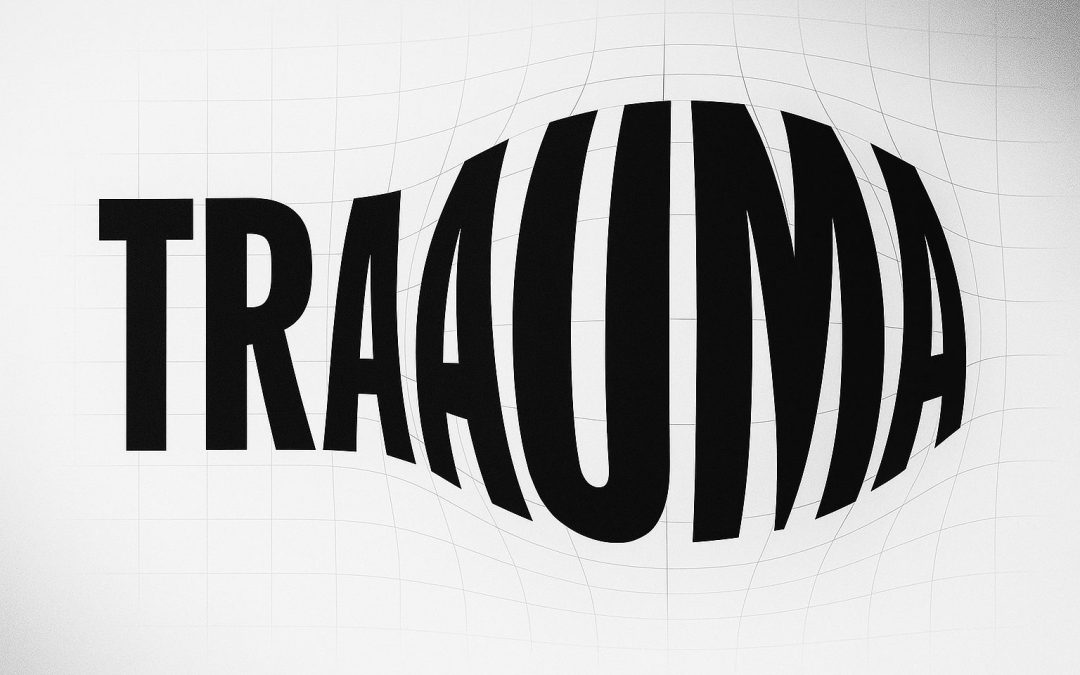
Commentaires récents